 Provenance – Ann Leckie
Provenance – Ann Leckie
Capitale futilité des chaussures (et des épingles à cheveux)
Ingray a des épingles à cheveux.
Oui, je sais : ce n’est pas ce que dit la quatrième de couverture : Elle fait plutôt mention du plan d’Ingray pour faire libérer Pahlad Budrakim, et promet moult rebondissements politiques à envergure interplanétaire. Vous êtes en droit d’attendre des intrigues, de la SF, des peuples extraterrestres dont les ambitions respectives se télescopent. Vous voudriez que je vous parle de la Fédération Omkemme désireuse de forcer la réouverture de certaines voies de commerce, de la présence impromptue de l’ambassadrice Geckque dont le peuple est connu pour ne jamais quitter sa planète d’origine, des tensions causées par les prochaines élections sur Hwaé, de la nature du traité que les différentes espèces de la galaxie ont passé avec les Presgers et qu’il s’agit de ne surtout pas enfreindre… Vous voudriez que je vous parle d’une intrigue complexe à même de vous passionner, pas que je me perde en trivialité dès les premières ligne de ma chronique.
Certes.
Mais pensez-y : il m’est possible de vous révéler le fin mot de l’histoire des épingles à cheveux d’Ingray sans rien vous spoiler de l’intrigue globale, d’aller avec vous jusqu’aux dernières pages du roman sans rien gâcher de votre (peut-être) future lecture, de tout vous dire sans rien révéler que vous auriez préféré ignorer.
Car, n’en faisons pas de mystère, en terme d’intrigue, les épingles ne servent à rien.
Elles ne sont qu’un détail, mais un détail visible, comme mit sous des projecteurs invisibles. Elles sont mentionnées dans les moments où la tension monte, alors que l’on prête attention à chaque micro-élément présenté. On les garde dans un coin de notre tête, au cas où elles s’avéreraient importantes pour la suite. Mais dans la suite, quand elles reviennent, c’est encore de façon triviale. Une fois, deux fois, trois fois, on croit reconnaitre un build-up : On attend le pay-off… qui ne vient pas.
Mais alors pourquoi en parler ? Pourquoi le faire juste assez souvent pour qu’il ne soit pas possible de les ignorer ?
Ce n’est pas de la caractérisation de personnage. L’histoire est racontée du point de vue d’Ingray, on ne s’éloigne jamais d’elle et on n’a donc aucun besoin d’un marqueur visuel pour la reconnaitre.
Ce n’est pas non plus une description parmi de nombreuses autres. Au contraire, le parti-pris de l’autrice est de faire le moins de description physique possible pour ne pas (j’y reviendrais) expliciter ce qui différencie les trois genres mit en scène dans l’histoire : les hommes, les femmes, et les næmmes. Aussi, nous ne savons que très peu de choses sur ce à quoi ressemblent les personnages, et sur Ingray, nous n’avons que trois éléments : elle porte une jupe, elle a dans les cheveux des épingles qui tombent, et les chaussures dont il est fait mention à la fin de l’histoire ne sont pas à elle.
Qu’elle importance ? Me direz-vous ?
C’est que voilà, les chaussures aussi ont leur importance secrète. Et cela, ce n’est pas moi qui le dit : sur les trois cartes-postale que l’autrice présente sur son site comme des cadeaux à offrir lors de ses dédicaces, l’une représente une paire de chaussure flottant dans l’espace.
Un internaute demande :
Cela m’est peut-être passé au dessus de la tête mais j’aimerais comprendre la signification des grosses chaussures dans la chambre de l’assemblée qui semblent mentionnée bien trop souvent pour n’être qu’un « élément » à jeter. Il y a même une image de ces chaussures ci-dessus dans votre post…..
[Source : blog d’Ann Leckie, Adam, Oct 2017]
Et Ann Leckie de répondre :
L’importance de ces chaussure est qu’elles ne sont pas à Ingray. Pour le reste, je dois laisser cela à l’interprétation des lecteurices.
[Source : blog d’Ann Leckie, Ann Leckie, Oct 2017]
Il n’y a pas grand chose à dire à propos des chaussures en réalité, elles apparaissent juste, quelques dizaines de pages avant la fin du livre, et pour une raison mystérieuse, des personnages (et ce jusqu’à la toute dernière page) se mettent à penser qu’elles appartiennent à Ingray (qui dément).
« Oh, tenez, n’oubliez pas vos chaussures. » Il accrocha son arme à son énorme flanc puis ramassa les chaussures, sous la banquette où Ingray s’était étendue, et les posa sur ses genoux.
« Elles ne sont pas…, commença Ingray »
[…]Les chaussures lui pesaient sur les genoux, presque des bottines, aux semelles épaisses, dures sans conteste trop grandes pour elle.
[p.371]
Pas grand chose à dire sinon à considérer une interprétation littérale et d’apparence déconnectée de l’histoire : les chaussures ont une charge symbolique. En anglais « To be in someone shoe (litt : être dans les chaussures de quelqu’un) » c’est se mettre à la place de l’autre, c’est devenir l’autre. En français « être bien dans ses pompes » c’est être à l’aise avec qui l’on est, « se tenir droit dans ses bottes », c’est être sûr de soi. La chaussure, métaphoriquement, compte. Il importe d’en trouver une paire à son pied, et il importe de reconnaitre quand la dite paire ne convient pas.
Ingray dit que les chaussures ne sont pas à elle : symboliquement, elle s’affirme enfin en temps qu’elle-même, sans tenter d’être (comme elle a tenté pendant tout le récit) quelqu’un qu’elle n’est pas.
Les chaussures sont importantes, non pas pour l’intrigue, non pas en décorum, mais parce qu’elles éclairent sur un autre registre l’avancement du développement psychologique du personnage principal.
Il en va de même, je pense, pour les épingles à cheveux. A la différence près que ces dernières ne décrivent pas seulement un état final, mais bien toute l’évolution d’Ingray.
Laissez-moi vous raconter l’histoire de Provenance à travers celle, capilaire, des épingles à cheveux d’Ingray :
Ingray est prête à tout pour obtenir l’approbation de sa mère Nétano Aughskold. Elle tente des années durant d’être la politicienne qu’elle n’a jamais été, de se plier aux règles d’un jeu auquel elle ne peut pas gagner, de faire tenir sur sa tête des épingles qu’elle n’a jamais su mettre. Elle le sait pourtant : les rares fois où elle ne tombent pas, quelqu’un d’autre s’est chargé de sa coiffure.
Une épingle à chignon verte à tête en verre tomba sur son épaule, puis par terre. Et merde ! Elle n’avait jamais su se coiffer correctement.
[…]Ingray ne répondit pas et regarda de nouveau ses pieds. Songea à se pencher pour ramasser l’épingle à cheveux par terre. Mais, avec sa veine actuelle, si elle se courbait pour ramasser celle-là, trois autres allaient tomber.
[p.36-37]
Mais puisque son désir de plaire lui fait prendre des risques, Ingray finit par s’attirer des ennuis. Et c’est là, alors qu’elle est retenue en otage, que figure cette scène :
« Mademoiselle Aughskold […] voulez-vous bien enlever vos épingles à cheveux ?
— Mais certainement. » répondit Ingray. Sa voix ne tremblait pas le moins du monde, fut-elle heureuse de constater. Elle retira ses épingles à cheveux et les tendit à la personne en armure qui venait de lui parler. « Que dois-je en faire ? »
La première personne en armure reprit la parole. Ingray ne savait pas bien dans quelle langue.
« Veuillez les déposer au sol, mademoiselle Aughskold, traduisit l’autre, et vous éloigner d’elles. »
[p.315]
Une scène qui de prime abord ne semble pas avoir grand sens, puisqu’à aucun moment les épingles ne sont présentées comme une arme ou un outil potentiel. Cependant Ingray ne semble pas surprise qu’on lui fasse cette demande, ne se dit pas « ses personnes doivent craindre que je me serve de mes épingles pour [insérer ici une explication quelconque] ». Nous n’avons donc, comme pour les chaussures, aucune hypothèse explicite, seulement celles que nous voulons bien formuler.
Je formule donc, comme métaphore du livre inclue et cachée dans le livre même : dans l’adversité Ingray renonce enfin à faire tenir des épingles dans ses cheveux.
Voilà donc ce sur quoi je voudrais m’étendre : ce que dit le livre de l’acte d’affirmation de soi.
Capitale futilité des genres
Pour ceux qui connaissent Ann Leckie, cela n’a rien d’une surprise, mais la question du genre est évidement présente dans le roman, elle l’était déjà dans la triologie des Chroniques du Radch, quoi que de façon différente.
Note sur le traitement du genre dans les Chroniques du Radch
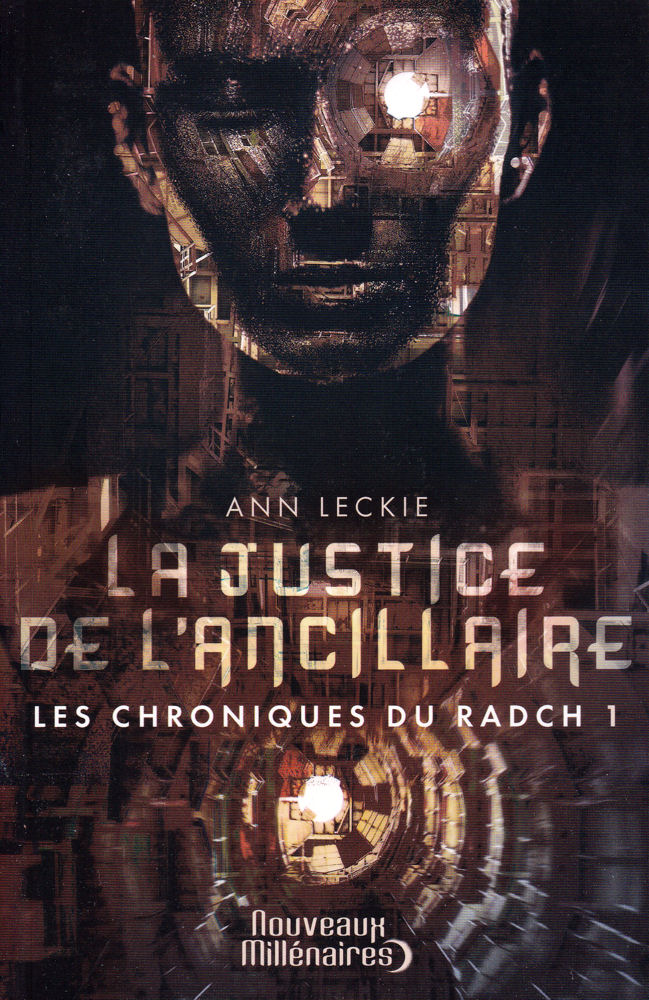 Dans le premier tome des Chroniques du Radch, on nous introduit la société Radchaaïe pour laquelle il n’y a qu’un seul genre : toute personne est désignée avec le pronom elle, des accords féminins, et des noms masculins (ce qui peut donner « elle est une citoyen investie »). La première conséquence de ce choix grammatical est, par le simple fait de montrer une société agenrée, une remise en cause de notre société binaire : les genres en effet sont des constructions sociales, et il est bien dit explicitement que les Radchaaïes sont humaines, et que si leur culture fait abstraction du genre, cela ne s’explique pas par des attributs sexuels particuliers qui seraient identiques pour toutes (comme c’était le cas par exemple dans la main gauche de la nuit, d’Ursula LeGuin, où tous les habitants de Nivoses sont genrés au masculin mais où il est explicitement dit qu’aucun d’eux ne possède ni vagin ni pénis la majeure partie du temps, la différenciation sexuelle s’effectuant de façon alternée et aléatoire quelques jours par mois seulement).
Dans le premier tome des Chroniques du Radch, on nous introduit la société Radchaaïe pour laquelle il n’y a qu’un seul genre : toute personne est désignée avec le pronom elle, des accords féminins, et des noms masculins (ce qui peut donner « elle est une citoyen investie »). La première conséquence de ce choix grammatical est, par le simple fait de montrer une société agenrée, une remise en cause de notre société binaire : les genres en effet sont des constructions sociales, et il est bien dit explicitement que les Radchaaïes sont humaines, et que si leur culture fait abstraction du genre, cela ne s’explique pas par des attributs sexuels particuliers qui seraient identiques pour toutes (comme c’était le cas par exemple dans la main gauche de la nuit, d’Ursula LeGuin, où tous les habitants de Nivoses sont genrés au masculin mais où il est explicitement dit qu’aucun d’eux ne possède ni vagin ni pénis la majeure partie du temps, la différenciation sexuelle s’effectuant de façon alternée et aléatoire quelques jours par mois seulement).
« Seuls les Radchaaïes se trompent dans le genre des gens comme vous le faites. »
J’avais mal deviné. « Je ne vois pas sous vos vêtements. Et même si je le pouvais, ce n’est pas toujours un indicateur fiable. »
Elle a battu des paupières, hésité un moment comme si ce que je venais de dire n’avait pour elle aucun sens. « Je me suis demandé comment les Radchaaïes se reproduisaient, s’ils étaient tous du même sexe.
— Ce n’est pas le cas. Et ils se reproduisent comme tout le monde. »
[La justice de l’Ancillaire, p.143]
On note dans cette scène que les Radchaaïes sont genrées au masculin : les deux protagonistes s’expriment dans une langue qui n’est pas le radchaaï et où le masculin sert de neutre. Ann Leckie joue beaucoup sur les différences de langue pour rendre le décalage en terme de gestion des genre : si nous lisons toujours du français, les accords changent selon qui s’exprime. Aussi, si la narration (faite par Breq, un ex-ancillaire radchaaïe) utilisera le pronom elle pour toutes les personnes, des ‘il’ apparaitrons parfois dans les dialogues.
Mais au delà de la remise en cause des critères d’affectation du genre, le point de vue du roman par une voix intérieure au Radch permet de mettre l’accent sur la fonction sociale des marqueurs linguistiques de genre. En effet, puisque toutes les Radchaaïes sont désignée par un féminin hégémonique, cela les place, selon leur propre norme, au dessus des autres : des qui IA ont des accords masculins (pronom il en français, it en VO) et des non-Radchaaïes qui doivent être genré.e.s différentiellement selon des critères qui échappent aux Radchaaïes.
« Je ne crois pas que vous connaissiez beaucoup de Radchaaïs. […] Vous voyez cela depuis l’extérieur, et vous voyez du conformisme et du lavage de cerveau. […] Il est vrai que le plus humble Radchaaï se juge infiniment supérieur à n’importe quel non citoyen. […] Mais ce sont des gens et ils ont différentes opinions sur les choses. »
[La justice de l’Ancillaire, p141]
En sommes, le choix de montrer une civilisation mono-genrée permet à Ann Leckie d’aborder le genre suivant un axe qui est d’abord social : le genre existe comme instrument de création d’une unité globale au sein de laquelle les individus doivent trouver leur place et leur singularité.
Or, ce mouvement de zoom est à l’image de tous les développements de la trilogie.
D’abord les enjeux politiques mit en avant : la société radchaaïe est présentée initialement comme étant un tout avec une mécanique d’homogénéisation bien huilée et un processus d’expansion constant qui vise à annexer les systèmes planétaires les uns après les autres pour faire de toutes les humains des citoyens radchaaïes. Les adversaires du Radch peuvent être transformé.e.s en Ancillaire (c’est à dire en marionnettes humaines que commandent par centaines les intelligences artificielles des vaisseaux), en interne, les contrevenants peuvent être envoyées en rééducation (ce que les non-Radchaaïes voient comme un lavage de cerveau), et les citoyens se voient attribuer un métier en fonction d’un test d’aptitude conçu pour maintenir l’ordre social. Mais l’on s’aperçoit que tout ceci est en train de changer, que depuis un millénaire des réformes vont dans le sens d’une certaine humanisation, c’est à dire d’une prise en compte des individus au sein de la masse.
Ensuite, l’évolution du personnage principal : Breq était autrefois le justice de Toren, un vaisseau composé d’ancillaires multiples, qui avait une vision presque omnisciente en son propre sein, mais dont l’un des Ancillaires (Un Esk Dix-neuf) particulièrement attaché à sa lieutenant (la lieutenant Awn) sent qu’il se dissocie du reste de lui-même, et finit par devenir vraiment indépendant quand le reste du vaisseau est détruit par Anaander Minaaï.
J’ai abouti à la conclusion que cette division moi-le Justice de Toren et moi-Un Esk, ne fut pas une soudaine scission, pas un instant où « je » était d’abord un, puis « nous ». Ce fut une éventualité qui avait toujours existé, toujours été potentielle. Reprimée. Mais comment était-on passé du potentiel au réél, à l’indéniable, l’irrévocable ?
A un certain niveau, la réponse est simple – c’est arrivé quand le Justice de Toren a été entièrement détruit, moi excepté. Mais quand j’y regarde de plus près, il me semble distinguer des fissures un peu partout. Le chant y a-t-il contribué, cette chose qui différenciait Un Esk de toutes les autres unités du vaisseau […] ? Ou l’identité de chacun n’est-elle qu’une affaire de fragments liés ensemble par une narration commode ou utile qui, en des circonstances ordinaires, ne se révèle jamais comme une fiction ?
[La justice de l’Ancillaire, p.277]
Enfin, les personnages centraux du récit avec lesquels Braq interagit :
- Anaander Minaaï, Maitre du Radch composée de millier de corps génétiquement identiques, est la personnalisation des enjeux de la société radchaaïe. Il y a mille ans, face au peuple Garsedaaï qu’elle a exterminé, une partie d’elle n’a pas su réagir aux atrocités commises et elle s’est déchirée en interne, éclatant en plusieurs sous-entités en conflit les unes avec les autres.
« Ça a commencé à Garsedd. Elle a été horrifiée par ce qu’elle avait fait, mais n’a pas pu décider comment réagir. Elle fait mouvement en secret contre elle-même depuis ce temps là. Les réformes – se débarrasser des ancillaires, arrêter les annexions, ouvrir les affectations aux maisons secondaires, elle a fait tout cela. Et Imé était l’autre partie d’elle, établissant une base et des ressources, pour partir en guerre contre elle-même et rétablir les choses telles qu’elles étaient. Et tout ce temps, la totalité d’elle a feint de ne pas savoir ce qui se passait, parce que dès qu’elle l’admettrait, le conflit éclaterait au grand jour, et ce serait inévitable. »
[La justice de l’Ancillaire, p.442]
- Seivarden, compagnon du héro tout le long du roman qui a passé mille an en hibernation, est là comme un rappel de ce que l’empire Radch a eu été. Aussi est-il particulièrement sensible aux changements qui se sont opérés pendant son millénaire de sommeil, et qui font de lui un étranger en son propre pays (il ne comprend même plus la langue qui a évoluées)
« [Au] bout du compte tu peux rentrer dans le Radch et trouver des gens qui te connaissent, des gens qui se souviennent de toi, personnellement, un endroit où tu as ta place, même si tu n’y est pas toujours. Où que tu ailles, tu appartiens encore à cet ensemble, même si tu n’y reviens jamais tu sais en permanence que c’est là. Mais quand on a ouvert cette nacelle de suspension, toutes celles qui avaient eu de l’intérêt personnel pour moi étaient déjà morte depuis sept cent ans. Sans doute d’avantage. »
[La justice de l’Ancillaire, p.298]
Là où les Chroniques du Radch mettaient en scène une société sans genre, Provenance décrit la société hwaéenne où les individus peuvent être classés en trois catégories distinctes : les hommes, les femmes, et les næmmes (neman en VO).
En surface, cela pourrait sembler n’être qu’un autre moyen de bousculer notre perception de genre, et s’en est un : puisque les Hwaéens reconnaissent les næmmes d’un seul regard, on ne peut s’empêcher de se demander ce qui les identifie, et l’on se retrouve de facto dans la position qu’avait Un Esk dans la justice de l’Ancillaire au moment de retrouver le Radch :
Je les ai toutes vues, subitement, juste l’espace d’un instant, par des yeux non radchaaïs, une foule fluide de personnes de genres d’une dérangeante ambiguïté. J’ai vu tous les traits qui marquent le genre chez les non-Radchaaïs – jamais, à mon grand agacement et à mon découragement, de la même façon ni au même endroit. Cheveux long ou courts, portés défaits (descendant dans un dos ou en un épais limbe frisé) ou noués (tréssés, épinglés, attachés). Corps épais ou mince, visage aux traits rudes ou délicats, avec des cosmétiques ou pas. Une profusion de coloris qui auraient été en d’autres lieux des indicateurs de genre. Tout cela associé au hasard, avec des corps incurvés à la poitrine ou à la hanche, ou pas, des corps qui, un moment, se mouvaient d’une façon que les non-Radchaaïs qualifieraient de féminine, et le suivant de masculine. Vingt ans d’habitudes m’ont rattrapés et, l’espace d’un instant, j’ai désespéré de choisir les pronoms corrects, les termes d’adresse appropriés. Mais je n’en avais pas besoin ici. Je pouvais laisser choir ce souci, un poids mineur mais agaçant que j’avais supporté tout ce temps. J’étais chez moi.
[La justice de l’Ancillaire, p.374]
Nous nous demandons : qui sont les næmmes ? Et précisément parce que l’autrice ne donne aucune piste de réponse, nous nous rappelons qu’elle ne peut pas en donner, comme nous même ne pouvons pas dire ce qui différencie les hommes et les femmes, toute tentative de le faire se résumant à l’énumération insupportable de mille et un clichés. Nous ne pouvons pas expliquer : nous savons, ou nous croyons savoir.
Les næmmes sont simplement là, avec leurs pronoms (iæl en français, e/em/eir dans la VO), des accords (grandæ, richæ…) et des noms spécifiques (nère, noncle…). Leur existence même nous rappelle l’arbitrarité des catégories de genre. Et ce d’autant plus d’ailleurs que la société hwaéenne n’est pas la seule dont il est question dans le roman : en plus de la brève apparition d’une radchaaïe (genrée au féminin « par convention »), une ambassadrice des Gecks (espèce non humaine possédant plusieurs genres parmi lesquels iels peuvent alterner) tient un rôle important.
« Je la connais depuis ma naissance. Enfin, elle a été il une partie de ce temps, et parfois quelques autres pronoms dont cette langue ne dispose pas, mais j’ai connu cette entité toute ma vie. »
[p.186]
Mais si le procédé semble identique (mettre en scène une société différente de la notre qui bouscule la notion de genre), il est intéressant de constater à quel point les implications en terme d’intrigue se distinguent dans un cas (pas de genre) et dans l’autre (des genres qui ne correspondent pas à ceux dont nous avons l’habitude).
En effet, dans une société fictive où le concept de genre n’existe pas, les personnages ne peuvent pas avoir été construits socialement en fonction de lui, et se conçoivent d’abord comme des personnes dans un tout (qui pourra connaitre des divisions mais sur des critères autre que le genre). Pour ces personnages, le genre sera forcément une considération extérieure, un élément perturbateur arrivé sur le tard. Et ce, au contraire des personnage qui grandissent dans une société genrée où, par définition, le genre est et a toujours été une composante majeure (sinon primaire, dans la mesure où l’on a tendance à assigner un genre aux gens que l’on rencontre de façon inconsciente avant même de leur parler) de leur identité.
Aussi, là où les Chroniques du Radch abordaient la question du genre de haut en bas, Provenance procède dans l’autre sens, de bas en haut : Dans Provenance, il ne sera pas question des dynamiques globales induite par le genre dans nos sociétés (société parmi lesquelles des individus évoluent), mais d’individus (individus faisant partie d’une société donnée) directement en prise avec le genre.
En conséquence, il y a dans Provenance tous les éléments pour aborder un sujet que les Chroniques du Radch avaient laissé de côté : la transidentité. Une problématique que l’on retrouve dans tous les développements du roman.
D’abord la description de société Hwaéenne en elle-même : En plus de ses trois genres reconnus, les enfants n’ont pas de genre attribué mais doivent en choisir un, et c’est seulement au moment de choisir leur prénom et leur pronom qu’on les considérera comme des adultes. De plus, quand une personne hérite d’une position sociale, elle hérite aussi du prénom de la personne qu’elle doit remplacer. Ces deux éléments combinés font que quasiment tous les personnages du livre pourraient se lire comme des personnes trans (en ce sens qu’ils/elles/iæls doivent revendiquer un genre qui ne leur a pas été assigné et choisir quel prénom sera le leur).
Ensuite l’évolution du personnage principal : rappelez vous des épingles à cheveux et des chaussures : tout l’enjeu pour Ingray sera de se défaire de ce que les autres (sa mère en particulier) attendent qu’elle soit (et que malgré toute sa volonté elle n’arrive pas à être), pour trouver qui elle veut être et s’affirmer enfin.
Nétano avait toujours traité ses enfants – tous adoptés – avec amabilité et générosité. Mais, du jour où elle était entrée dans la maison, Ingray avait su que son bien-être futur dépendait du fait qu’elle ne décevrait pas sa mère adoptive. […] Nétano voulait que ses enfants soient extraordinaires. […] Qu’on déçoive ses attentes et on était éliminé. Jamais cela n’avait été exprimé par qui que ce soit dans la maison, mais [tout le monde] le savait […].
Ingray avait toujours le sentiment de ne pas se trouver à sa juste place, comme si, à tout moment, Nétano Aughskol devait se rendre compte que jamais Ingray n’aurait le genre d’audace géniale que sa mère prisait.
[…]Elle déposa sa poignée d’épingles à tête verte à côté d’elle sur la couchette et les compta. Il en manquait une, probablement tombée en route […].
Si seulement. Si seulement elle était ce qu’elle s’était efforcée d’être tout ce temps.
[p.39]
Enfin, les personnages centraux du récit avec lesquels Ingray interagit :
- Taucris Ithesta (la copine d’Ingray) est la seule à être en questionnement sur son genre : elle a mit de très longues années à se décider sur un prénom/pronom, au point que son entourage avait commencé à penser qu’elle resterait enfant toute sa vie. Mais une fois décidée, pour des raisons essentiellement pratiques, elle n’est toujours pas très convaincue, et semble particulièrement enthousiaste (bien que la scène soit brève) à l’idée que les Geckques puissent changer de genre plusieurs fois au cours de leur vie.
« Et bien sûr, Nana voulait vraiment que je choisisse, iæl a essayé d’être patientæ mais iæl ne comprennait vraiment pas. […] Et dans l’ensemble je suis contente de l’avoir fait. Je tenais tant à ce travail, je suis ravie de l’avoir enfin de façon certaine, officielle. Mais… tu ne pas pas de moquer de moi, hein ?
— Non, bien sûr que non » […]Taucris hésita encore un instant, au bord de dire quelque chose, puis elle déclara enfin : « Ingray, comment as-tu su ? Comment as-tu su que tu étais prête ?
— Je l’ignore, répondit-elle, désarçonnée par la question. Il m’a juste semblé que tout le monde attendait de moi que je choisisse, je suppose.
— Mais je ne me suis jamais sentie… adulte. Je ne me le sens toujours pas, pas réellement »
[p.141]
- (TW : Transphobie) Phalad Budrakin / Garal Ket est le personnage qui a le plus de sous-texte trans. 1. On le rencontre alors qu’iæl a été envoyæ au retrait compassionnel, une sorte de prison dont le nom n’a rien d’innocent : c’est un lieu où l’on envoie des criminels que l’on déclare mort pour ne plus avoir à se soucier de leur sort. Or Phalad/Garal est innocentæ. Iæl a été envoyæ là (après avoir découvert quelques vérités) par son père qui craignait pour sa réputation (et sa carrière politique). Lisant cela, on ne peut que penser à toutes les personnes trans (ou queers au sens large) rejetées par leur famille au moment où elles font leur coming-out / se font outer. Un retrait compassionnel, littéralement. 2. Conséquence subsidiaire d’avoir été déclaréæ mortæ, Phalad/Garal est en prise avec l’administratif (je ne vous fait pas un dessin sur l’infini complexité de la moindre démarche de transition). 3. Phalad/Garal est læ seulæ à avoir deux identités. Aussi, si Ingray (dont la narration suit le point de vue) passe sans problème d’un nom à l’autre (à partir du moment où elle décide, conformément aux requêtes de l’intéressæ « Phalad… non Garal » ou respectivement « Garal… ou plutôt Phalad », elle s’y tient) de nombreux autres personnages persistent à se tromper (ie : le deadnament), parfois volontairement.
« [Iæl] était citoyennæ hwaéennæ, mais iæl a été déclaréæ légalement mortæ. Iæl n’était pas censé pouvoir rentrer un jour sur Hwaé, mais iæl l’a fait, avec une fausse identité obtenue de façon illégale. »
L’émissaire fronça les sourcils. « Et donc iæl ne possède aucune citoyenneté nulle part ? Iæl n’a aucune existence légale en tant qu’humain ?
— Grosso modo », acquiesça Ingray.
[p.199]« Vous avez volé jusqu’ici depuis la capitale ce matin pour me crier vos questions en personne, mais vous n’arrivez pas à employer le nom par lequel je veux qu’on m’appelle. Aucun de vous n’y arrive, apparemment, sauf la Voix du Secteur, ici présente. »
[…]« Mais vous ne pouvez pas décider comme ça du nom que nous voulons vous donner, protesta Chorem Caellas, une femmes courte et massive du service le plus populaire à l’échelle de la planète.
— Je ne parlerai qu’à la voie du Secteur, déclara Garal.
[p.244]
Note où je râle à propos des traducteurices
Les deux séries (la trilogie des Chronique du Radch, et le roman Provenance) ont été traduit par la même personne : Patrick Marcel. Et je tiens à dire qu’il a fait dans l’ensemble du très bon travail : parce qu’il y avait des enjeux majeurs sur ces romans, qu’il y avait des choix à faire qui ne coulaient pas de source, ne serait-ce que parce que les marqueurs de genre ne se situent pas aux mêmes endroits en anglais et en français. La décision par exemple de faire parler les Radchaaïes dans un féminin hégémonique qui a certaines composantes masculines (les noms, qui en anglais ne sont pas genrés) est un choix audacieux et très réussi.
Oui sauf que : sur Hwaé les enfants n’ont pas de genre. En VO, leur pronom est they, they qui peut je le rappelle servir de pronom singulier neutre (et ce depuis des siècles, hein, même sans parler de non-binarité, c’est l’usage quand on veut parler de « someone » dont on ne sait pas le genre, par exemple « oh, someone forgot their decency »), et cela a été traduit par… ils.
« D’ici là, je dois me préparer pour une réception. C’est aujourd’hui qu’on nomme Taucris Ithesta.
— Quoi ? » La surprise sortit Ingray de sa feinte colère. « Ocris a enfin choisi ? » Ocris, qui avait l’âge d’Ingray, avait été une enfant calme, mal à l’aise en nombreuse compagnie. Ingray les appréciait, mais après avoir revendiqué sont propre nom d’adulte, elle avait très peu vu Ocris. Elle les avait presque oubliés.
Danach eut un petit rire. « Je me disait qu’ils…. pardon, qu’elle, n’y arriverait jamais. »
[p.109]
Sérieusement, ça me fatigue.
Je veux dire, d’accord, en l’occurrence, ce n’est qu’une page, on peut passer outre, on peut même trouver des justifications qui font à peu près sens (de type : on parle d’une société alien inventée spécialement pour ne pas considérer le genre de la façon dont nous le considérons dans la vraie vie, se sont des enfants qui portent en potentialité les trois genres parmi lesquels leur choix pourra se porter plus tard, pourquoi pas un pluriel ?).
Mais en vérité c’est toujours la même histoire (on a déjà eu le cas avec la cité de l’Orque de Sam J Miller, pour ne citer que cet exemple particulièrement désastreux), et je suis prête à le parier : le traducteur ne savait pas. Il a été forcé de trouver le iæl pour traduire le ey inconnu, mais voyant un they connu (ou qu’il croyait connaitre), il ne s’est pas posé de question.
Et c’est si désespérant. Non qu’il ne sache pas, je ne veux pas faire un plaidoyer contre lui (il y a un mois encore, n’ayant lu que la justice de l’Ancillaire, je le citais en exemple de « vous voyez c’est possible de faire une bonne traduction ! »), mais que la norme soit de ne pas savoir.
Comment exprimer à quel point ça use, quand on est queer, quand on est si enthousiasmé.e.s de trouver des livres qui parlent de nos problématiques lgbt+, et qu’on s’aperçoit que les personnes qui traduisent nos récits ne se sont pas données la peine de se renseigner un minimum ? Parce que oui : le they comme neutre, c’est une information facile, vraiment très facile, à trouver. C’est peut-être même la première information sur laquelle on tombe par hasard quand on commence à se renseigner sur le genre (et ce même quand on ne cherche pas, comme un.e traducteurice pourrait chercher, à avoir un point de vue anglophone sur la question).
A bien des égards, cela peut sembler n’être qu’un détail, mais les détails comptent. Et celui ci m’a fait douter de tout le reste des parti-pris de traduction (qui pourtant m’enthousiasmaient beaucoup à l’origine) : pourquoi par exemple coller des æ partout quand il est question des næmmes (ce qui n’est pas du tout le cas dans la VO) ? Pourquoi ne pas dire plus sobrement les « nammes » ? Pourquoi ne pas utiliser un pronom véritable, tel ul ou ol (en laissant le iel, contraction de il et elle, aux enfants) ? Pourquoi sinon par volonté d’alteriser à outrance la possibilité même d’un genre neutre en lui associant une lettre qui n’existe pas en français ?
(Et pourquoi également avoir fait le choix d’un masculin grammaticalement hégémonique ? Pourquoi garder cette règle idiote du « masculin qui l’emporte sur le féminin (et sur, du coup, le neutre des næmmes) » ? Pourquoi entériner cette idée d’un masculin plus neutre que… le neutre ?)
Capitale futilité des preuves
Tout au long de ma lecture de Provenance, j’ai beaucoup repensé à l’essai de ïan Larue : Libère toi cyborg ! (sous titré : le pouvoir libérateur de la science fiction féministe) dans lequel est fait une grande place à la question des origines (et d’un certain schéma Biblique où la faute originelle est attribuée à la femme, et où l’apocalypse est une menace constante qu’il convient d’éviter en s’assurant que surtout rien ne change ni ne se mélange).
Rien de plus patriarcal que les fictions où Moi-le-Mec non féministe n’arrête pas d’ennuyer tout le monde avec des questions bêtes, genre qui suis-je, d’où viens-je et qui est mon père. Cette obsession-là dans la fiction patriarcale est le reflet de nos mentalités. […] La médecine, point nodal de l’angoisse occidentale contemporaine, est particulièrement riche en propositions culpabilisantes où la confusion de la cause et de l’origine débouche sur des consignes morales. […]Le cyborg, en rejetant ce réflexe conditionné de la pensée des origines, permet donc aussi de réfléchir sur ce poids psychique que nous subissons quand l’origine des choses est considérée comme la cause de tout. Oublier l’origine permet aussi d’oublier ce qu’on doit être à tout moment, du CV à facebook, de l’entretien d’embauche au dîner mondain : un tout cohérent.
[Libère-toi cyborg !, p.31]
Le roman en effet fait une grande place à l’obsession des origines, et à la difficulté de la concilier avec le devenir personnel d’individus, en particulier quand ces individus ne sont pas « Moi-le-Mec non féministe ».
Car le problème n’est pas seulement que certaines personnes s’intéressent à leurs origines, ce qui est tout à fait leur droit (et peut même s’avérer intéressant si le savoir récolté ne sert pas de preuve pour légitimer un ordre des choses). Le problème est qu’il y a une injonction, y compris pour les personnes que cela n’intéressent pas, à regarder vers le passé. Une injonction parfois si forte qu’il ne s’agit plus seulement d’appuyer une identité en racontant sa genèse (car nous avons tous besoin d’histoires), mais qui réciproquement se donne le droit d’invalider des identités sous prétexte qu’elles n’ont pas de preuve d’être ce qu’elles sont.
Dans ce paradigme, certaines personnes, parce qu’elles sont en position de domination, n’ont pas à rechercher de preuve : tout l’imaginaire collectif s’est déjà chargé de leur trouver mille récits fondateurs qui les légitimisent. Quand aux autres, le fait de peiner à exister auprès des dominants ne les empêchent pas de reproduire les mêmes mécaniques délétère sur d’autres minorités.
Note illustrant la manière dont l'injonction à la preuve est excluante
(TW : LGBTphobies au sein des communautés)
C’est une chose que l’on peut observer notamment très bien dans la communauté LGBT+, où régulièrement des controverses tentent d’exclure une lettre ou l’autre.
Et toujours, l’exclusion est justifiée par un appel aux preuves (à la matérialité donc) :
- On exclu les asexuel.les/aromantiques parce qu’iels ne peuvent pas prouver n’avoir aucune attirance (surtout s’iels ont malgré tout des rapports, et s’iels n’en ont pas, iels ne sont matériellement rien d’autres que des célibataires), on dira qu’iels sont peut-être simplement en conflit avec le patriarcat qui impose ses standards en terme de couple et de sexualité, que c’est bien, mais que cela n’a rien à voir avec l’identité.
- On exclu les bi/pan parce qu’iels ne peuvent pas prouver leur attirance pour des personnes de genre divers une fois en couple avec une seule personne (matériellement et selon les cas, on dira qu’iels sont « devenu homo/hétéro »), on dira qu’iels sont peut-être simplement en conflit avec le patriarcat qui impose de différencier/préférer soit les hommes soit les femmes, que c’est bien de ne pas vouloir le faire, mais que cela n’a rien à voir avec l’identité
- On exclu les personnes non-binaire parce qu’iels ne peuvent pas prouver leur ressenti, on dira qu’iels sont peut-être simplement en conflit avec le patriarcat qui impose ses standards et ses clichés sur ce que doivent être un homme/une femme, que c’est bien de remettre cela en cause, mais que cela n’a rien à voir avec l’identité
- …
Dans tous les cas, l’accusation prend toujours cette forme : « Je ne sais pas, mais dans le doute (et même si tu es sûr.e de toi), je vais partir du principe que tu as tort. Tort d’être ce que tu es. Tort de penser ce que tu penses. » Dans tous les cas, cela relève d’une peur sous-jacente, celle de ne pas réussir à construire le discours uni et cohérent que les dominants demandent : une narration plurielle est vu comme nuisible pour la communauté dans son ensemble (car si les dominants feront des amalgames, autant ne leur parler que des expériences qu’iels sont le plus à même de comprendre, c’est à dire dont iels sont les plus proches, c’est à dire qui sont la frange la plus privilégiée parmi les nombreuses minorités)
Et pourtant comment pouvons nous espérer gagner en reconnaissance sans nous reconnaitre entre nous ? Sans donner à entendre la multiplicité de nos voix (parfois incohérentes entre elles) ?
Demander des preuves, c’est souscrire à la mentalité-même dont on voudrait s’extraire, celle des dominants. C’est la garantie de ne jamais gagner, de ne faire au mieux que recréer en miniature les modèles que l’on dénonce, où un groupe domine les autres et impose ses conditions. Dans la communauté LGBT+, les hommes cisgenre gay sont ainsi les seuls à ne jamais être remis en cause, les seuls à ne pas avoir besoin d’un drapeau spécifique : voyant le rainbowflag, ils disent « ceci est le drapeau gay », parce que dans les milieux LGBT+, ils sont la norme, le neutre, le quasi-apolitique. Ils sont la non-radicalité par défaut.
On ne peut que le constater : les luttes des minorités « manquent d’unité », « sont divisées ». C’est le constat que font les ennemi* de ces luttes, qui roulent sur du velours car les militant* sentent bien que c’est vrai. Mais pourquoi le reprocher ? Qui dicte l’obligation d’avoir « les mêmes idées » quand on entreprend quelque chose, sinon l’adversaire qui stigmatise la « division » elle-même ? [Il] faut renoncer à l’idée même qu’un* quelconque individu* ou un groupe puisse former une unité. […] Telle est « l’identité cyborgienne » : pas de petite case à cocher, pas de « tout cohérent » mais une kyrielle de contradictions internes qu’on laisse voguer avec insouciance.
[Libère-toi cyborg !, p.136]
Dans le roman Provenance, la question des preuves est, indissociable de l’affirmation de soi, au coeur des préoccupations des personnages.
Ainsi Ingray, enfant adoptée (comme la plupart des gens sur Hwaé) a particulièrement conscience qu’elle doit faire ses preuves auprès de sa mère : elle n’est pas acceptée par défaut en raison d’une filiation directe. Elle a été choisie, certes, et doit à présent s’en montrer digne. Tout le développement dont elle fait l’objet part de cette prémisse de base : elle n’est pas légitime a priori, n’ayant pas cette « preuve » toute trouvée que pourrait constituer un lien filial classique. Or on a beau lui dire que cela n’a pas d’importance, elle sait – tout le monde sait – que cela en a :
« Ta mère s’estime très égalitaire, très démocratique, nota noncle Lak. Elle était décidée à donner à ses enfants adoptés dans une crèche publique – c’est à dire à toi, et à Vaor avant qu’iæl s’en aille – toutes les chances d’hériter. Mais semble-t-il, ils n’ont jamais eu ce certain je ne sais quoi«
[p.399]
Et bien sûr (vous commencez à voir je pense que pas grand chose n’est fait par hasard dans ce livre : que chaque sous intrigue est un rappel des autres, jusqu’aux épingles à cheveux d’Ingray), dans chacune des trois civilisations présentée au cours du roman (dont l’imbrication des intrigues politiques constitue la trame principale du récit, et oui, j’en parle seulement maintenant u.u) il est question de preuve (montrée comme un artifice politique dont la valeur est relative au pouvoir qu’elle confère à qui la possède) :
- Sur Hwaé, une importance démesurée est portée aux vestiges, des objets d’apparence anodines qui peuvent valoir des fortunes. Collectionnés et exposés, ils servent à légitimer la famille qui les possède. C’est le fait de découvrir que la plupart des vestiges sont des faux qui vaut à Phalad/Garal d’être envoyéæ en retrait compassionnel (pour couvrir l’affaire, iæl est accusé d’avoir volé et remplacé les originaux). Quand la vérité est dévoilée, Ingray réalise que cela ne change rien : même s’ils sont falsifiés, les vestiges ont toujours de l’importance parce que les Hwaéen.ne.s continuent de leur en accorder une. Même si elle n’est pas authentique, une déclaration exposée dans un musée pendant des générations est chargée d’une certaine historicité, et d’ailleurs, si le support est usurpé, il n’y a pas d’erreur sur le texte, et c’est cela qui compte.
« Et je n’avais jamais pensé de cette manière avant. Qui sommes-nous si nos vestiges ne sont pas authentiques ?
— Vous n’y avez jamais réfléchis avant parce que personne n’a jamais vraiment remis en question le fait que vous soyez qui vous dites être. Personne n’a jamais annoncé que vos vestiges sont faux, ou qu’ils signifient en fait que vous n’êtes pas tout à fait hwaéenne.
— On m’a déjà dit que je n’étais pas une vraie Aughskold » rappela Ingray. Sur la défensive. Se sentant insultée, pour une raison qu’elle ne pouvait définir. « Je viens d’une crèche publique ».
[p.238]
- Sur Omkem, personne ne comprend le principe des vestiges. En revanche, beaucoup d’argent est dépensé pour effectuer des fouilles dans le parc naturel d’Eswae (situé sur Hwaé) pour tenter de prouver que les collines de verre sont en fait les ruines d’une ancienne occupation humaine, et ainsi réécrire (de la manière qui les arranges) le mythe du berceau de l’humanité. A ce titre, un duo omkem est envoyé sur Hwaé dont les deux membres ne peuvent littéralement pas ce parler : l’étiquette l’interdit. La première, persuadée d’œuvrer pour la science (« vous voyez bien » dit-elle « que savoir votre passé c’est savoir qui vous êtes »), affirme que son intérêt est totalement apolitique, ce qui ne leurre personne. Le second, trainé de force sur le lieu de fouille, se désespère de perdre son temps et son énergie :
« Le Directorat consacre des sessions entières à débattre d’effectuer des expéditions telles que celles-ci. Mais vous croyez qu’il accorderait la moindre attention à… » Il parut se retenir, de raviser sur ce qu’il allait dire. « Ou est-ce qu’il pense à envoyer des représentants au conclave ? » Il émit un bruit dégoûté. « Je préférais être chez moi, à défendre ce sujet bien plus capital. »
[p.118]
- Enfin, sur Gecks, monde autarcique aquatique, quitter la planète est considéré être un sort atroce, presque pire que la mort, ce qui dénote d’un certain attachement aux origines, mais bizarrement renversé : en effet, ce peuple non-humain est disposé à accorder instantanément la citoyenneté geckque à toute personne (humaine ou non) qui en ferait la demande, et ce sont les personnes (à l’instar du capitaine Tic Uisine) qui veulent partir qui doivent fournir des explications. L’arc de l’Ambassadrice geckque sera de prendre conscience de ses biais : ce n’est pas parce que ses origines (géographiques) sont vitales pour elle qu’elle le sont pour quiconque.
« J’ai peur, je ne veux pas être hors du monde. Mais je regarde, j’entends, j’écoute. Vous êtes étranges, Ingray Humaine, mais vous ne semblez pas vivre dans la douleur et le chagrin constant. Non, vous nagez ici comme si ceci était le monde et vous vivez votre étrange vie comme si tout était bien et bon. Et je me dis : n’est-ce pas ici que vivent les humains ? ils ont éclos hors du monde ; ceci est leur eau d’origine. Les éclos au bord du monde, agissons-nous mal en les gardant ? »
[p.279]
Si vous avez aimé cet article, vous pouvez me soutenir !
