Plan
- Introduction : qu’est-ce qu’une structure narrative ?
- Le « monomythe » —Et pourquoi c’est pas la panacée
- La gentrification des structures —Ou pourquoi la littérature est plus riche qu’on ne le pense
- Le neuf n’existe pas —Ou alors, il est partout
- Parlons des livres de mes invité·es —Un échantillon enthousiasmant de la littérature d’aujourd’hui
- Conclusion – Existons ensemble
- Bibliographie
NB : Cet article a été réalisé à partir de retranscriptions d’interviews orales exclusives de (par ordre alphabétique) Ketty Steward, Sabrina Calvo, Sam Marriem Corrèze, Saul Pandelakis et Sofia Samatar.
L’interview conjointe de Sofia Samatar et Sam Marriem Corrèze ayant été réalisée en anglais, leurs propos ont été traduits.
Introduction
Qu'est-ce qu'une structure narrative ?
Les personnes qui connaissent mon blog ne seront pas surprises de voir apparaitre cet article sur les structures narratives : trois de mes dernières publications se terminaient par une note indiquant qu’un jour, j’écrirais sur les structures narratives. Il fallait bien que je m’y attèle.
Et pour commencer, soyons basiques : définissons les termes.
Car une structure narrative, selon qui emploie le terme, peut désigner plusieurs choses.
On dit parfois « j’ai structuré mon récit » pour dire qu’on a organisé les chapitres ou les éléments de l’histoire/du livre dans un certain ordre : pour gérer la tension sans qu’il y ait de creux dans le récit, pour faire des regroupements thématiques, pour s’assurer que la fin n’arrive pas comme un cheveu sur la soupe, etc.
Personnellement, ce n’est pas cela que j’entends par « structure ». J’appelle cette partie « planification » et c’est à dessein que je l’expédie : une telle conversation touche à la manière dont chaque personne aborde sa propre écriture, c’est intéressant, mais cela finit très vite par tourner en rond autour de la même question « alors toi, t’es plutôt jardinier ou architecte ? ». Question à laquelle il ne peut y avoir qu’une seule conclusion honnête : la plupart des gens sont de toute façon entre les deux, et puis de toute façon tout le monde fait bien comme il veut, c’est presque comme si les êtres humains étaient tous différents, incroyable/s
Ketty Steward : On finit toujours par structurer à un moment ou à un autre. Certaines personnes vont penser à ce qu’elles ont envie de construire avant de commencer à écrire, moi ne je sais pas faire ça, mais il y a quand même toujours un moment où il me faut structurer. Plus le projet est long plus je vais avoir besoin de le faire en amont. Par exemple Confessions d’une séancière, j’ai fini le truc, j’ai choisi l’ordre [des textes] (parce que c’est pas par hasard que tu choisis l’ordre), et une fois que j’ai choisi mon ordre je me suis rendue compte qu’il manquait deux textes. Donc j’ai écrit ces deux manquants.
Outre le plan, la structure peut aussi désigner certains choix narratifs :
Saul Pandelakis : Au début je pensais que [l’article] allait peut-être être plus porté sur la manière dont on compose l’objet. Par exemple dans La Séquence Aardtman y’ a une rythmique, une alternance de point de vue qui est composée. […]Est-ce que toi quand tu fais des paragraphes tu vas à la ligne ? Pas à la ligne ? Tu fais des chapitres de deux pages ? De vingt pages ?… Ce sont des choix. Oui y’ a une part d’intuition, mais y’ a un moment donné quand même où tu prends du recul sur ce que tu fais, où tu te dis « ok ça je veux, ça je veux pas, etc ». Me concernant, je veux pas donner l’impression non plus que tout ça est une permanence d’écriture libre où je sais jamais ce que je fais. C’est pas vrai. Je serai pas honnête en disant ça.
Personnellement, j’appelle plutôt cela « la forme ». Et notez bien que cela n’a rien de péjoratif. La forme et de toute façon au service du fond (ou devrait l’être), et on aura surement l’occasion d’en reparler (seulement, ce sera en tant qu’« outil au service de… » et pas en tant que focale principale de cet article).
Ketty : Mais quand tu disais Eva « ça c’est une question de forme », moi je vois pas comment tu peux réfléchir à la forme sans qu’il y ait un lien avec le fond. Écrire un truc parce que « ça se serait beau », mais que ça n’ait rien à voir avec ce que t’essaies de raconter, moi ça me pose problème aussi, tu vois ? Ça existe hein, des bouquins comme ça, mais c’est chiant. Tu vois bien que la personne essaie de te montrer sa jolie technique.
Ce que j’entends par « structure narrative », c’est en fait la forme générale du texte, la ligne tracée entre le point de départ et le point d’arrivée et qui passe par toutes les péripéties intermédiaires.
Pour prendre une métaphore que je trouve parlante : si un roman (ou une histoire en général) est un nuage de points (chaque point représentant une scène), alors la structure est une régression (linéaire ou non) que les lectaires peuvent tracer par dessus le nuage pour mieux en saisir l’essence. Cette régression est possible peu importe que les autaires aient eux même tracé (puis gommé) des lignes de construction imaginaires pour placer leurs points avec précision (planification), et peu importe le type de points qu’iels ont choisi d’utiliser (forme) : de simples points ne dévoilant qu’un instant à la fois ou bien des bulles couvrant des moments plus vastes, des points colorés dont chaque couleur représente un point de vue différent au sein d’un récit polyphonique, des points avec des barres d’erreur, etc.
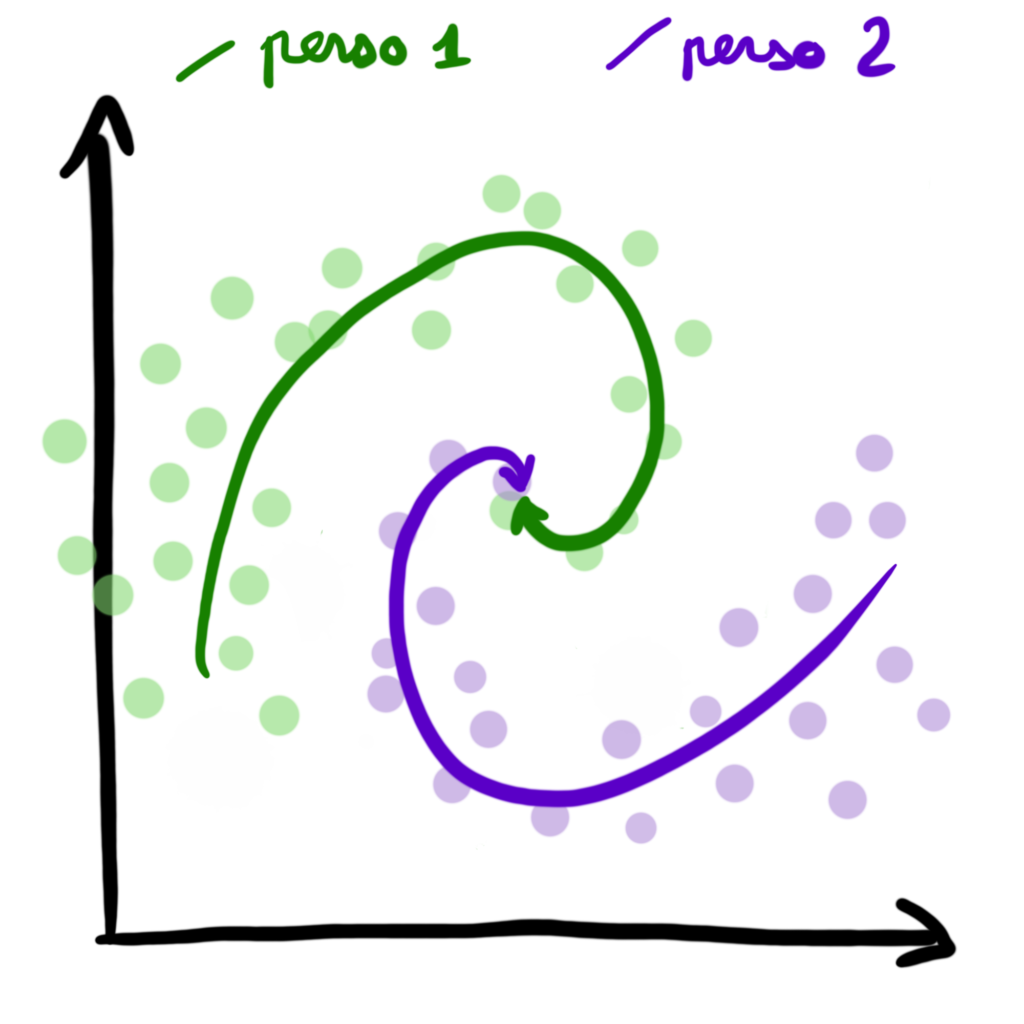
Je suis fasciné par les structures narratives. Et en même temps (et c’est peut-être pour cela qu’elles m’intéressent), je me rends compte qu’elles sont rarement discutées.
D’abord, du côté lectaires, parce que souvent quand on est devant un film ou plongés dans un livre, on se laisse porter par les émotions du moment, par la poésie, par la personnalité des protagonistes, par la tension qui nous happe, etc. La structure n’apparait que si on prend du recul par rapport à l’œuvre pour essayer d’en comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui demeure très facultatif.
NB : je ne porte ici aucun jugement moral sur « devriez-vous faire plus attention aux structures ». Pour ma part, je crois que je les cherche inconsciemment chaque fois que je lis, notamment parce que la lecture est une activité au long cours qui ne mobilise qu’un seul de mes sens (la vue), et que si la structure est « trop classique » ça ne va pas me donner assez de grain à moudre pour maintenir mon intérêt : soit je vais lire un bout et manquer de motivation pour poursuivre, soit je vais lire tout d’une traite et oublier la totalité presque immédiatement.
En revanche, quand je regarde un film, je vais être submergée par mille informations simultanées : des voix (et leurs intonations), des musiques et bruits de fond, des expressions faciales, des décors, des coupures et des transitions, des actions rapides que je ne peux pas ralentir, etc. Aussi je vais me laisser porter par tout ceci et n’avoir aucun problème à consommer des films ultra prévisibles au point où ils sont presque sans âme (je les aime pour ça, les pauvres. Enfin aussi : les « téléfilms clichés romances/films de sport/films pour ados/comédies » que je consomme donnent un aperçu, sinon de ce qu’est la vie sociale, au moins de la manière dont la plupart des gens la fantasment. Et c’est plutôt autistique de ma part d’apprendre les codes sociaux en regardant les Disney Channel Original Movie ou de regarder des comédies au premier degré comme si c’était des drames sociaux tout à fait sérieux)
Bref tout ça pour dire : on peut s’intéresser ou pas aux structures narratives quand on lit/regarde un film/joue à un jeu vidéo. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon d’apprécier une œuvre. Moi-même je fais les deux. Fin de la parenthèse.
Ensuite, du côté des autaires, parce qu’il y a un spectre qui va
- d’un côté aux personnes qui édictent des règles comme si elles étaient universelles (spoiler: non) et continuent de louer le « monomythe » de Joseph Campbell (dans le but de ne pas faire de prosélytisme, j’ai donné une chance à une masterclass d’écriture, espérant qu’il y aurait plus à y trouver qu’un manuel pour reproduire la norme littéraire… mais… bon ça ne m’a pas convaincu, on va dire) : ces gens là voient la structure, mais ne la questionnent pas, se contentent de la reproduire « parce qu’elle marche ».
- de l’autre aux personnes dont la devise pourrait être « je m’en fous, je fais juste ce que je veux » : ces gens-là, justement parce qu’iels questionnent les structures traditionnelles, s’efforcent de les mettre à l’écart de leurs écritures et de leurs pensées.
Sabrina Calvo : Je me suis jamais réellement intéressée aux structures narratives dans mon travail personnel parce que j’ai un processus de création qui est complètement déstructuré. La structure ne m’apparait que très tardivement dans mon travail, et au moment où je la vois j’fous une couture dessus, comme ça, ça tient, et puis voilà.
Il existe aussi, entre les deux (ou sur un troisième sommet du triangle ?), des gens qui pensent la structure narrative de leurs propres récits avec une démarche très consciente de la changer (comme par exemple Oasis Nadrama, une autrice et amie qui a beaucoup influencé mes réflexions en amont de cet article : elle est la personne la plus planificatrice, ou en tout cas self-aware des effets qu’elle entend produire avec ses propres textes, et je sais qu’elle met un point d’honneur à ne pas reproduire des récits qui s’inscrivent dans une tradition pseudo-universelle occidentale : il en va de sa praxis [elle adore ce mot]).
Mais de fait, la plupart des personnes que j’ai interrogées ne se posent pas tant de questions : elles écrivent principalement guidées par leurs instincts et leurs envies.
Sofia Samatar : Je pense que Un étranger en Olondre est un bon exemple de ce procédé consistant à choisir ce que l’on aime et ce que l’on n’aime pas. Moi, j’ai grandi avec Tolkien, j’adore ces livres, j’adore l’épique fantasy. C’est un de mes premiers amours en tant que lectrice. Mais il y a des éléments que j’adore vraiment dans ce genre, et d’autre… pas tant. J’adore les cartes, les voyages, le fait qu’il y ait plusieurs langages qui cohabitent et plusieurs cultures qui entrent en contact. Je n’aime pas les batailles ou l’idée d’un talisman magique spécial. Je suis ok avec la magie, mais sans plus. Alors j’ai écrit un roman de fantasy qui comprenait tous les éléments que j’aime, et qui n’avait pas le reste, ce qui ne m’importe pas.
Mais alors, me demanderez-vous : pourquoi cet article ?
Parce qu’au-delà de l’intérêt personnel que je leur porte, je crois que les structures ne s’appellent pas « structures » pour rien : même lorsqu’on ne les voit pas, elles structurent la manière dont on pense, à force de répétition elles nous font intérioriser des schémas qu’on finit par ne plus questionner.
C’est l’histoire qui fait la différence. C’est l’histoire qui me cachait mon humanité, l’histoire que racontaient les chasseurs de mammouth à propos de raclée, de viol, de meurtre, à propos du Héros. L’histoire merveilleuse et empoisonnée du Botulisme. L’histoire-qui-tue.
[Ursula Le Guin, Théorie de la fiction panier]Sabrina : Ben je pense que les structures narratives, c’est comme tout système structurel à l’œuvre depuis des temps immémoriaux : à un moment donné ça a servi à cristalliser des sens, des symboles sous un maillage de réseau de symbolique, et ce réseau symbolique à des moments donnés a été plus ou moins essentialisé par les oppresseurs pour en faire le mode par défaut de comment organiser la réalité, qui est elle-même un maillage symbolique. Donc la structure narrative pour moi ne vaut qu’en tant qu’objet d’étude particulier de système d’oppression. […]En fait qu’on se soit encore attaché·es à certaines structures narratives aujourd’hui prouve bien que à un moment donné on n’a pas su dépasser le sens de ses créations artificielles, et, encore plus dangereux : c’est qu’on a prêté à ses créations artificielles des vérités et des paramètres qui ont de tout temps bouché quelque part les évolutions potentielles de la conscience et de la société.
À partir du moment où l’on reconnait un certain nombre de structures narratives comme des cristallisations d’une norme (littéraires et sociales, les deux se renforcent mutuellement)…
Sam Mariem Corrèze: Les archétypes suivent ou influencent la société. Les uns sont le reflet de l’autre. Je suppose qu’en fantasy, quand le héros est toujours un homme, toujours un guerrier, toujours quelqu’un de puissant et toujours quelqu’un qui s’avère être hétérosexuel et finit avec la fille… cela dit quelque chose de la manière dont la société voit la masculinité et la romance, etc.
Ketty : Moi ça me parle d’Histoire (l’Histoire, la grande histoire) parce qu’en fait le narratif de fiction et l’Histoire comme discipline, il me semble qu’il y a des liens assez forts. Pour moi il y a comme une évidence de l’Histoire qui est racontée par les vainqueurs : il y a une volonté de faire quelque chose de cette matière qui est disponible pour démontrer qu’on a raison d’être qui on est, de faire ce qu’on fait, qu’on est les meilleurs, qu’on a dans notre sein des gens tellement valeureux… Et effectivement il me semble que faire différemment en fiction c’est aussi regarder cette grande Histoire différemment. Je vois des liens en tout cas dans la démarche : donner la parole à ceux qui ne sont pas les vainqueurs, essayer de comprendre ce qui se passait, dans le peuple de vainqueur, pour ceux qui n’étaient pas spécialement engagés dans les grands combats ou dans les questions de riches, remettre du paysan dans l’Histoire de France par exemple. Pour moi ça va dans une nécessité de pluralité qui est vraiment un truc qui m’anime en tant que personne, en tant qu’écrivaine, en tant que psychologue, en tant que présidente du réseau université de la pluralité, enfin partout quoi. Qu’est-ce qu’on peut savoir de nous si on le regarde d’un seul point de vue ? Rien. On sait quelque chose de celui qui regarde, c’est tout.
… alors il devient nécessaire d’étudier l’objet d’étude qu’elles représentent : parler de ces structures narratives qui me posent problème. Et dans le même temps, puisque je refuse de me plaindre sans rien proposer : donner la parole à des autaires qui, à mon sens, produisent des œuvres qui sont intéressantes en termes de structures.
Remarque un peu méta sur la structure « narrative » de cet article :
Vous l’avez peut-être remarqué : je n’ai pas encore présenté mes invité·es. Peut-être que vous ne les connaissez pas (ou pas toustes), ou peut-être que vous les connaissez sans vraiment les relier à la thématique de ce présent article. Il est vrai qu’en général, il convient d’introduire chaque personne en amont. Mais c’est à dessein que j’ai choisi de faire autrement : si je parle d’abord des super romans de mes invité·es pour ensuite revenir sur des histoires basées sur des structures narratives plus conventionnelles, je grille tout l’espoir avant même qu’il ait eu le temps de s’épanouir. Ce n’est pas l’histoire que je veux raconter.
La vérité c’est que critiquer autrui peut vite devenir paralysant pour soi-même (et à dire vrai : je pense qu’une partie de la nécessité de cet article et née pour moi d’une confrontation entre la moi qui écrit, qui le fait de manière totalement intuitive et non planifiée, et la partie de moi qui tient ce blog, qui est passionné de structures narratives et aimerait bien planifier assez pour s’assurer de produire une œuvre avec une structure intéressante). Comme le dit Alice Zeniter à la fin de son essai Je suis une fille sans histoire :
Bon […] Nous sommes tous d’accord sur le petit sentier, chacun dans notre domaine : on arrête tous ces récits qui ne marchent plus, qui sont devenus nuisibles. Mais en étape 2, maintenant qu’on a obtenu le silence, on raconte quoi ?
[…]Théoriquement [l’idée de faire autrement] me parle, ça me plait beaucoup, mais concrètement, je ne suis pas sûre de savoir quoi raconter. Plus j’y pense et moins les récits me viennent.
[Alice Zeniter, Je suis une fille sans histoire, p.94]
Voilà pourquoi, je raconte à l’envers : je pose les bases de ce qui me pose question, et ensuite j’ouvre avec des œuvres de qualité et sur ce que je vois en elles.
Le "monomythe"
Et pourquoi c'est pas la panacée
Comme j’ai défini les structures narratives (sorte de régression faite sur les nuages de scène que sont les romans), on pourrait penser qu’il en existe des milliers possibles : les droites, des polynômes de divers degrés, des sinusoïdes, des logarithmes ou des exponentielles, que sais-je encore.
En un sens, c’est vrai : rien dans l’absolu ne devrait limiter la variété des structures narratives possibles. Sauf que dans les faits, des règles ont été fixées.
Le roman est fondamentalement une forme d’histoire non héroïque. Bien sûr, le Héros y a souvent pris le pouvoir. […] Il a décrété, à travers la voix de ses porte-paroles, les Législateurs : premièrement que la forme adéquate du récit est celle de la flèche ou de la lance, partant d’ici et filant tout droit jusque-là, et TCHAK ! touchant son but (qui tombe raide mort) ; deuxièmement, que la principale affaire du récit, y compris du roman, c’est le conflit ; et troisièmement, qu’une histoire n’est pas bonne si lui, le Héros, n’en fait pas partie.
Je suis en désaccord avec tout cela. J’irai même jusqu’à dire que la forme naturelle, ajustée, adéquate du roman serait plutôt celle d’un panier, d’un sac. Un livre contient des mots. Les mots contiennent des choses. Ils portent des sens. Un roman est un sac-médecine, contenant des choses prises ensemble dans une relation singulière et puissante.
Une forme possible de cette relation entre les éléments d’un roman peut bien être celle du conflit, mais réduire le récit au conflit est absurde.
[Ursula LeGuin, Théorie de la fiction panier]
Les structures narratives ont été essentialisées en une seule structure monolithique que Joseph Campbell a appelée « Le monomythe » (théorie développée dans son essai daté de 1949 : Le héros aux mille et un visages. D’après cette théorie, tous les mythes [de tout temps et de toutes les cultures] peuvent s’ancrer dans un schéma unique, car les mythes servent à véhiculer des vérités universelles.
[Notez que Campbell n’est ni le seul ni le premier à avoir essayé de définir UNE bonne/unique façon de raconter des histoires. Dans son essai Je suis une fille sans histoire, Alice Zeniter met en scène un cours d’écriture fictif donné par Aristote : outre le fait que le passage est extrêmement drôle, cela a le mérite d’insister sur le fait que l’idée d’une structure narrative hégémonique ne date pas d’hier].Saul : ça me fait écho au « monomythe » de Joseph Campbell que j’avais étudié quand j’ai écrit ma thèse, avec vraiment l’idée qu’une bonne histoire, ou une histoire classique, c’est un héros [plutôt un que une] qui rencontre un obstacle, y’a des adjuvants, y’a d’autres obstacles ou des gens qui se mettent en travers de son passage, et y’a une forme de transcendance qui se manifeste à la fin, quand le conflit et résolu.
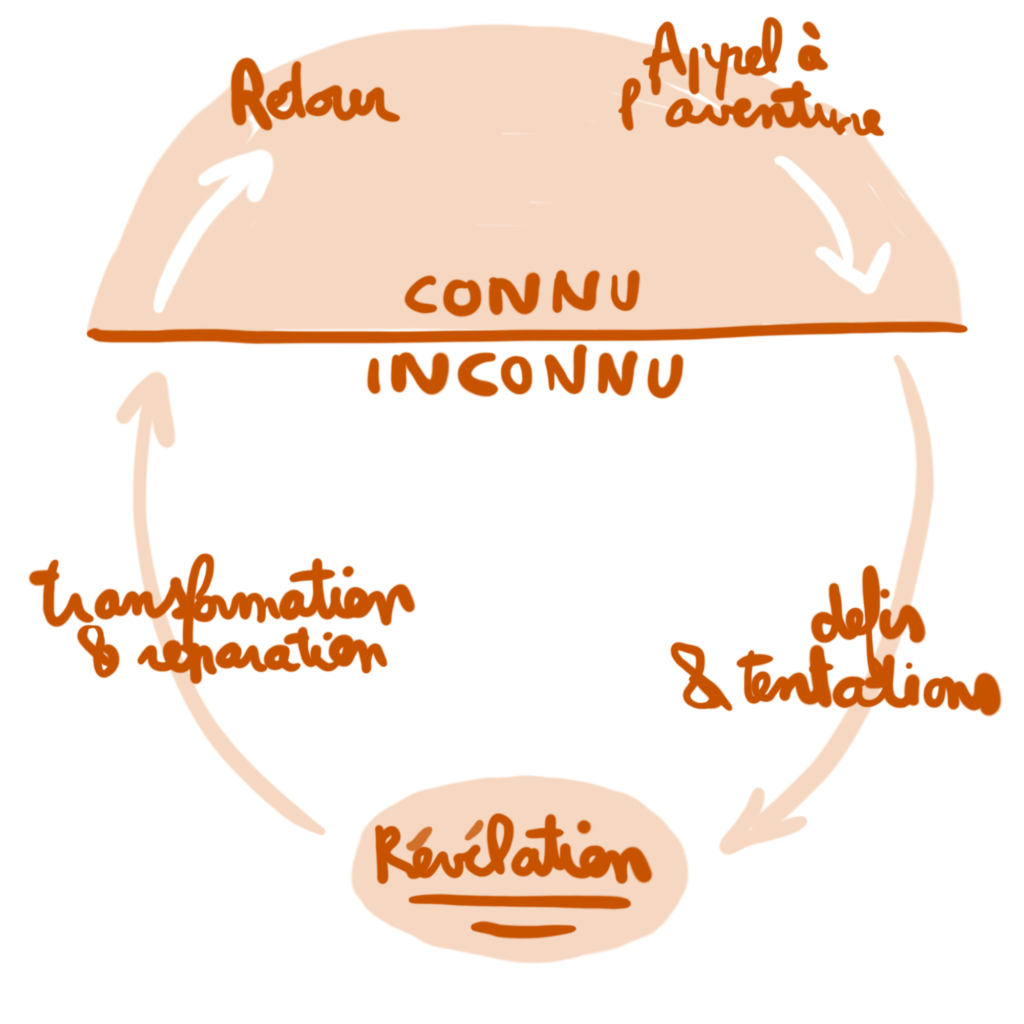
Mais concrètement, il y a au moins trois façons de schématiser le monomythe.
La première décrit l’objectif visé par le monomythe : montrer le héros qui revient à lui-même transcendé par son voyage parce qu’il a surmonté les obstacles. C’est le schéma proposé par Campbell et il se présente sous la forme d’une boucle : le héros franchit dans un sens, puis dans l’autre après avoir connu une révélation, la frontière « connu-inconnu ».
La deuxième est une description plutôt factuelle (et temporelle) du déroulé des évènements de l’histoire. C’est la courbe la plus simple qui correspond à la définition que j’ai donnée au début d’une structure narrative comme une courbe tracée par dessus le nuage de point que constitue chaque scène.
Il y a une situation initiale, un élément perturbateur, une série de péripéties qui font monter la tension dramatique jusqu’à un point de rupture (aussi appelé « climax »), puis il y a une stabilisation vers une situation finale différente de la situation initiale (le héros ayant grandi/changé).
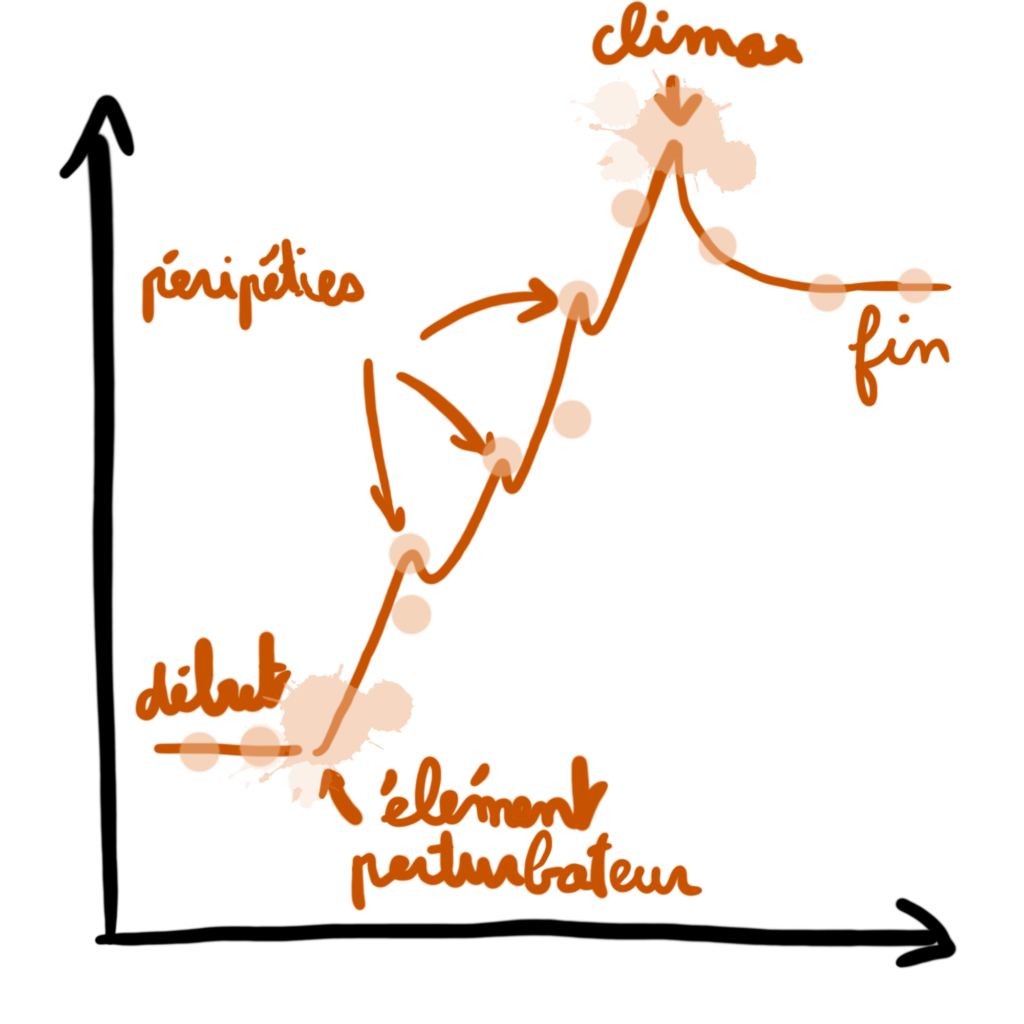
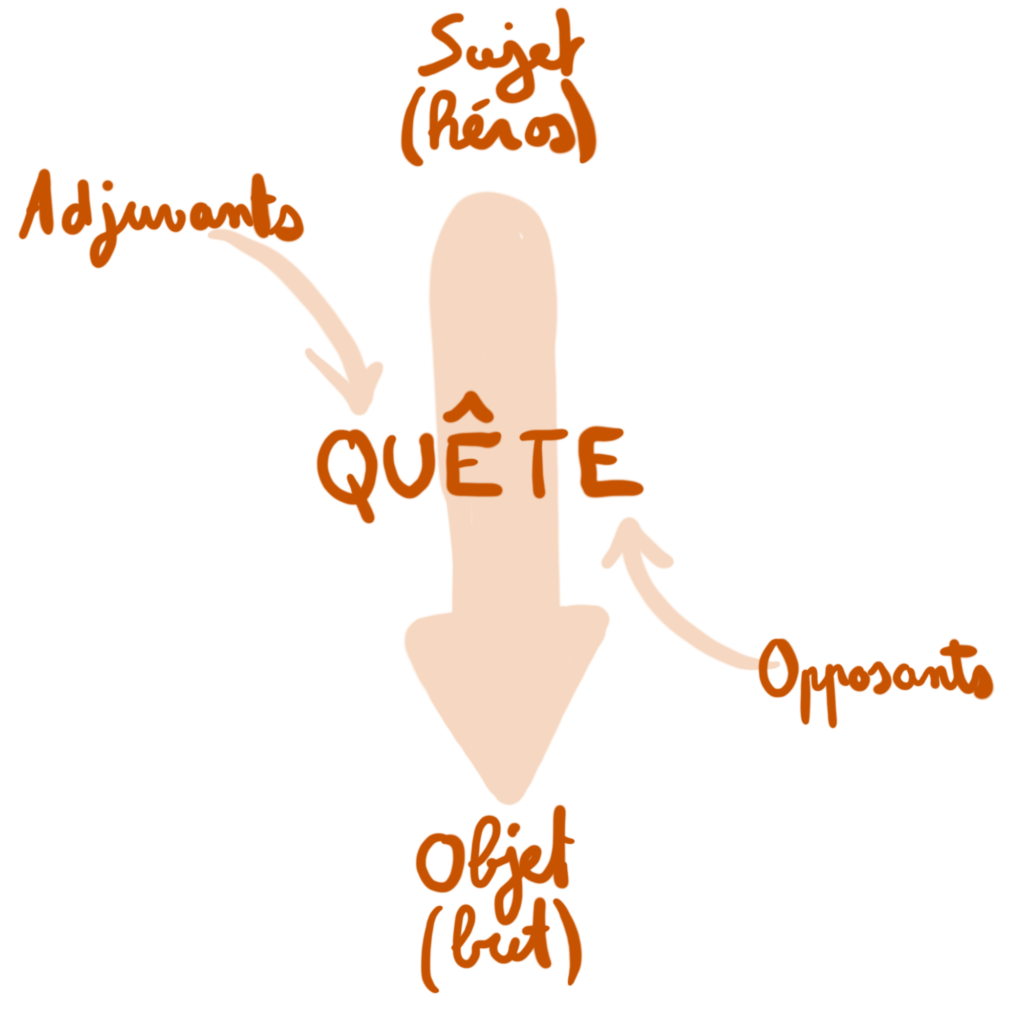
Enfin, on peut représenter la structure classique avec un schéma actanciel, qui représente, pour chaque moment de l’histoire, les motivations qui guident les actions du protagoniste : Il y a une flèche (la quête) qui va du sujet (le héros) à l’objet (de sa quête), des adjuvants et des opposants pouvant influer sur la trajectoire de la flèche.
Cette représentation insiste particulièrement sur le fait que l’action est au cœur du récit.
Sam : Je pense que les lectaires attendent de lire des histoires où quelque chose se produit. Parfois, on écrit des textes où rien ne se passe, très contemplatifs, et je ne sais même pas si ces textes peuvent être qualifiés d’histoires ? À tout le moins, ce sont des textes qui racontent quelque chose. Peut-être, je n’en suis pas sûr, que les gens attendent que les textes soient toujours des « histoires », avec un début, un milieu et une fin. […] Quelque chose doit se dénouer. Il y a un nœud, un problème avec lequel le protagoniste doit interagir pour le résoudre, ou le dévoiler.
Si tout ceci vous est familier, c’est normal : c’est au programme des cours de français de collège (moi j’ai appris ça en 6e ou en 5e). Normalement, cela seul devrait vous mettre la puce à l’oreille : au collège, on apprend les bases, c’est-à-dire une version extrêmement simplifiée de la réalité.
À mon sens, les « règles » de narratologies sont comme les petites roulettes sur les vélos : c’est pratique quand vous êtes enfants pour apprendre à tenir l’équilibre sans tomber. Mais aucune des personnes qui pratiquent le cyclisme à un niveau un peu sérieux ne garde des petites roues : très vite, elles gênent dans les virages.
Saul : Quand je pense à une structure narrative classique… déjà j’ai l’impression que ça veut pas forcément dire grand-chose parce que dès que tu cherches une forme classique, partout, dans l’histoire de l’Art, ou en cinéma, ou ailleurs, tu trouves que des exceptions à ta règle, au final. Donc c’est toujours un peu bizarre.
Cela étant dit, quel est le problème avec le monomythe ? Car après tout, si le modèle est si répandu, c’est bien qu’il doit avoir des avantages.
Sofia : La définition facile de « classique » c’est juste quelque chose qui est répété. Si une chose persiste assez longtemps, les gens la qualifieront de classique. Cela voudra dire qu’elle n’a pas disparu, qu’elle a continué à être répétée. Et cela voudra dire que… les gens doivent trouver de la valeur à cette chose. S’ils la trouvaient sans intérêt, ils ne la répèteraient pas.
Le premier problème avec le monomythe
Le premier point (et je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler) c’est que cette histoire de monomythe est terriblement occidentocentrée : c’est vouloir faire rentrer tous les mythes de toutes les cultures dans un schéma global penser par, pour et autour de l’occident. Ça me semble fort tendancieux comme démarche (euphémisme).
Le hasard a fait qu’alors que je m’occupais des transcriptions des interviews pour cet article, on m’a recommandé deux vidéos (en anglais) sur la chaine de Xiran Jay Zhao : l’autrice (dont le roman Iron Widow vient de sortir en français) a réuni sur un discord plusieurs personnes d’Asie du Sud-est pour produire une analyse exhaustive des milles et un détails du film Disney : Raya et le dernier dragon. Le tout consiste en une série de présentations (de type PowerPoint avec des voix off) détaillant le contexte de sortie et les inexactitudes dans la représentation de l’Asie du Sud-est (cultures, worlbuilding, langue, nourriture, armes, etc., etc.). Une troisième vidéo du même acabit est prévue pour parler du queer baiting dans le film. Une des présentations, intitulé « histoire et thème » fait particulièrement écho à ce que j’entends par « structure terriblement occidentocentrée » : L’histoire de Raya est très « monomythique ». Il y a un élément perturbateur (la pierre qui protégeait le monde de Komundra des terribles Drun est cassée puis disséminée), ce qui force l’héroïne Raya à partir à l’aventure (pour réunir les bouts de pierre et sauver le monde), au cours de son voyage, elle va rencontrer divers personnages et finalement apprendre à accorder sa confiance.
Nos narrations sont souvent plus centrées sur les relations intracommunautaires que sur un protagoniste extraordinaire. Dans nos histoires, cela peut se traduire par des systèmes de castes plus élaborés que celles que l’on rencontre généralement dans des histoires occidentales. Les personnages influencent et sont influencés par leurs relations au sein de leurs communautés, et les relations qui sont au cœur de l’histoire constituent le plot lui-même. La relation entre le protagoniste et les personnages adjuvants n’est pas un échange unidirectionnel servant d’abord au développement du protagoniste. Il y a souvent une influence mutuelle, pour le meilleur et pour le pire. Les relations n’ont pas à être centrées autour du protagoniste, les personnages secondaires peuvent avoir des liens importants les uns avec les autres dont le protagoniste est témoin (spectateur thématique).
Je trouve qu’avec la globalisation des médias, la popularité croissante des anime et manga, beaucoup d’autaires occidentaux qui ont grandi dans des sociétés individualistes ont essayé d’imiter ce qu’iels aimaient dans nos histoires, mais sans avoir conscience de la manière dont notre culture impacte nos travaux. J’ai remarqué que quand les autaires occidentaux essaient d’imiter l’aspect « community-driven » de nos histoires asiatiques, iels ont tendance à uniquement en saisir la surface. Le protagoniste incarne toujours des idéaux individualistes, les personnages secondaires sont généralement sous-développés et réduits à des archétypes unidimensionnels, le protagoniste n’est ni construit par ni constitutif de sa communauté. C’est généralement un échange à sens unique où les personnages secondaires aident au développement du protagoniste.
Raya souffre de ces mêmes biais.
[How Disney Commodifies Culture—Southeast Asians Roast Raya and the Last Dragon (Part 1), Présentation “Story & themes” réalisée par Serat, Lune, Jes & Cin Wibowo, Stephani Soejono, IslandBard et Tran]
(Notez que comme le répètent à plusieurs reprises les personnes à l’origine de la vidéo : le fait que le film Raya et le dernier dragon soit construit de manière « typiquement occidentale » n’est pas un problème en soi. Mais pour un film qui se présente comme « authentiquement Sud-est asiatique », cela finit par illustrer assez bien ce qu’est l’appropriation culturelle : reprendre quelques éléments d’une culture (ici c’était plutôt plusieurs cultures amalgamées, il semble), mais sans vraiment qu’il y ait d’échange ou de réelle compréhension. On se contente d’appliquer un vernis de « représentation et diversité » sur une structure narrative qu’on ne questionne pas)
Pour en savoir plus sur la pluralité des structures narratives à travers le monde, voir ce très long article en anglais sur le site de Kim Yoon Mi : Worldwild story structures. De nombreux modèles sont présentés, l’idée n’étant pas forcément de tous les apprendre (moi même j’ai fait que survoler), mais ça fait parfois du bien de se rappeler la pluralité des histoires possibles (qui ont des points communs ET des différences).
Le second problème avec le monomythe
Le second point, c’est que parfois, le fait de faire coller (volontairement ou non) une histoire au monomythe peut en diminuer la portée politique (ce qui, vous noterez, est seulement un problème quand on veut écrire des histoires qui ont une portée politique, mais comme c’est mon cas…).
Le truc c’est que d’une manière ou d’une autre, il y a plusieurs paramètres quand on écrit, et qu’ils ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Par exemple, la combinaison « personnage principal attachant » + « c’est l’histoire d’un serial killer » + « le tout n’est absolument pas dérangeant » me parait délicate à obtenir.
Aussi, quand la structure narrative n’est pas compatible avec le(s) messages(s) que l’autaire voudrait faire passer à travers son histoire, et que la structure narrative « campbellienne » n’est pas questionnée (considérée comme immuable, « si je bouge ça mon histoire ne va pas être intéressante/pas publiable »), c’est souvent le message et la portée du texte qui se trouvent diminuées. Et je trouve cela fort dommage.
Pour reprendre le cas de Raya et le dernier dragon : le message que veut envoyer le film c’est « Raya doit apprendre à faire confiance aux gens, car c’est sa suspicion qui cause des tensions ». Sauf qu’il « fallait » un élément perturbateur pour pousser Raya dans son aventure, il « fallait » créer des tensions pour qu’elles puissent être résolues, et donc il « fallait » donner à Raya des raisons de ne pas faire confiance spontanément aux autres : le film débute alors qu’elle est enfant et qu’elle se lie d’amitié avec Namaari, une fille d’un autre clan, qu’elle lui fait confiance pour lui montrer où est la pierre, et qu’elle se fait trahir. Namaari vole la pierre, qui se brise, ce qui cause l’apocalypse et la statufiction du père de Raya. Dans ce contexte, l’histoire aurait pu raconter comment Raya apprend à choisir à qui accorder sa confiance après avoir vécu une si vive trahison, ou comment elle pardonne à Namaari, ou comment Namaari travaille à se racheter…
Mais l’histoire est lancée suivant d’autres prémisses : la pierre est cassée, chacun des cinq clans de l’histoire en a récupéré un morceau, en termes de cohérence thématique, il « fallait » que l’arc de Raya parle d’union, de confiance.
Tous les éléments du récit s’emboitent parfaitement bien, les motivations du protagoniste (Raya) répondent aux enjeux du worldbuilding. Disney est une machine parfaitement huilée : écrire un récit qui fonctionne n’est pas un problème pour eux.
Sauf qu’en termes de message, le film finit par dire qu’il faut faire confiance à tout le monde, y compris aux personnes qui nous ont déjà trahis à deux reprises (oui y’ a une deuxième trahison).
NB sur les derniers films Disney-Pixar
En fait, je trouve que Raya est un bon exemple pour illustrer ce qui, à mon sens, a tendance à pêcher chez les films Disney, puisqu’il cumule deux pis-aller récurrents (enfin trois si on ajoute « le queer baiting et le fait de queer-coder les méchants ») :
D’abord, le fait de baser son récit sur une structure narrative bien rodée, sans penser qu’il serait parfois opportun de modifier cette structure quand elle diminue la portée symbolique, politique ou émotionnelle du film.
C’est ce qui arrive à la fin d’Encanto : dans le film, la famille Madrigal possède une bougie qui donne à chaque membre un pouvoir spécial. Mais les tensions intrafamiliales (liées aux traumas de la grand-mère) finissent par affaiblir la bougie qui s’éteint, la maison est détruite, tout le monde perd son pouvoir.
Il y a alors une scène super forte où tout le village vient aider les Madrigal à reconstruire leur maison : en remerciement pour tous les services rendus par les Madrigal depuis qu’iels ont leur bougie, et parce que « le vrai miracle, ce n’est pas les pouvoirs, c’est nous tous ». Sauf que : une fois la maison reconstruite, Mirabel ouvre la porte et MAGIE tout revient comme avant. Pour moi, cela détruit tout l’enjeu dramatique dans le seul but de coller à l’idée d’un happy end.
C’est d’autant plus dommage qu’en réalité, la plupart des pouvoirs des Madrigal ne sont… pas franchement désirables : entre l’oncle qui voit le futur et que tout le monde finit par voir comme un oiseau de mauvais augure au point qu’il passe dix ans à se cacher dans les murs de la maison avec les rats (how fucked up), la cousine qui entend absolument tout (dans la vraie vie, on appelle ça une hypersensibilité et c’est un handicap), la tante qui se prend des trombes d’eau sur la tête chaque fois qu’elle est triste, la sœur super musclée qui est juste corvéable à merci et l’autre sœur qui est enfermée dans son rôle de miss parfaite… Mais l’histoire comptait déjà deux chansons où chacune des deux sœurs fait la paix avec son pouvoir, sans compter l’oncle qui lui aussi a un arc d’acceptation de sa précognition, et partant de là il aurait été dommage qu’iels perdent leurs dons au moment où iels commençaient à les aimer.
Ensuite, le fait de présenter une histoire comme universelle alors qu’elle ne l’est pas.
Dans Raya et le dernier dragon, c’est certes bien d’encourager « dans l’absolu » les gens à se faire confiance mutuellement, et à collaborer. Mais le film ne prend pas en compte les cas où la personne en face n’est vraiment pas digne de confiance. Aux personnes coincées dans des relations toxiques, le film semble dire « reste, s’il te traite mal c’est de ta faute : tu ne lui montres pas assez que tu crois en lui, et c’est ce dont il a besoin ».
Il y avait quelque chose de similaire dans Soul : On y suit Joe, un homme noir américain fan de jazz (il ne parle littéralement que de ça, il veut à tout prix devenir musicien pro et pas simple prof de musique dans un collège) qui a un accident et, suite à une série de quiproquos se retrouve non pas dans l’après vie, mais dans « l’avant-vie » où il rencontre 22, une jeune âme qui n’a pas envie de naitre, car elle se trouve bonne à rien.
Le « voyage du héros » va consister pour les deux personnages à découvrir que la vie ne se limite pas à avoir « une vocation », et que l’on peut être très heureux même si on n’accomplit rien d’extraordinaire.
A priori donc, un chouette message.
Sauf que pour aboutir à cette conclusion, on nous montre 22 piloter le corps de Joe : mais elle n’est pas Joe, et tout le monde la préfère elle, du barbier qui est ravi d’enfin avoir avec « Joe » une discussion qui ne tourne pas autour du jazz, à la mère de Joe qui dit pour la première fois à son fils qu’elle est fière de lui au moment où… ce n’est pas son fils.
Le truc c’est que, la manière dont Joe est passionné par le Jazz au point d’être incapable de parler de quoi que ce soit d’autre, pour moi, c’est clairement un intérêt spécifique. Joe (on le voit quand 22 prend les commandes) est aussi particulièrement sensible aux bruits de la ville (il va se rouler en boule dans un coin parce qu’une voiture est passée près de lui). Bref pour moi ce personnage est clairement autiste. Et ce que le film finit par dire c’est : « Tu vois, tout le monde te préférerait si tu n’étais pas autiste ». (Je l’ai mal pris xD).
(Note que j’ai vu des personnes noires faire à peu près la même critique : ce que le film semble leur dire c’est « tu vois, n’importe quelle âme indéterminée donc non-racisée donc blanche gérerait mieux ta propre vie que toi ». À la différence que si l’équipe du film a pu ne pas se rendre compte que leur personnage est autiste-codé, elle savait forcément qu’il est noir)
Précision importante : le fait qu’une histoire s’inscrive dans un schéma un peu traditionnel basé sur du conflit et des épreuves à surmonter n’est pas une mauvaise chose en soi. Parfois, c’est l’histoire qu’on a envie de lire/d’écrire, et c’est très bien. Sans compter que, rappel, si certaines structures sont si courantes, c’est parce qu’elles marchent. Elles marchent sur moi, probablement sur vous également.
Bien sûr, là j’ai l’air de me moquer de tout ça : les personnages remarquables, le schéma triangulaire affuté… mais ça marche sur moi aussi. J’y suis très sensible même. Je pleure beaucoup devant les films ou en lisant des livres. Si un personnage que j’aime meurt, je fonds en larmes — je n’ai aucun esprit critique dans ces moments-là, je n’analyse pas les constructions, je les prends en plein cœur.
[Alice Zeniter, Je suis une fille sans histoire, p.45]Sabrina : Ce qui ne m’empêche pas de faire des scènes qui sont ultrabasiques. Je fais des scènes des fois qui ressemblent à des scènes que t’as déjà vues dans plein de films. C’est correct de le faire aussi quoi. J’ai pas honte de le faire aussi. Tu fais ce que tu veux en fait.
Concrètement, je pourrais citer des œuvres réactionnaires écrites par des auteurs qui utilisent des structures « monomythique » pour se prouver à eux-mêmes que les hommes comme eux sont meilleurs que les autres. Il y en a. (Et j’ai déjà parlé des films Disney où les volontés artistiques quand elles existent doivent composer avec les intérêts financiers de la mégacompagnie)
Mais ce qui me semble davantage intéressant, c’est de regarder de quelles manières les structures peuvent impacter des œuvres pour lesquelles j’ai de l’attachement et de la sympathie. Par exemple, Mers mortes est un roman d’Aurélie Wellenstein dont le plot m’attirait depuis longtemps : dans un futur post-apocalyptique où les océans ont disparu, des spectres de mammifères marins reviennent hanter les humains par vagues. Le héros, Oural (un exorciste chargé de protéger les habitants de sa ville) est un jour enlevé par l’équipage d’un bateau fantôme. L’enjeu sera alors, pour lui et ses nouveaux compagnons, de trouver comment refaire la paix avec la nature mutilée… et peut-être même : ressusciter les océans.
Tout cela promettait un conte écologique dans une ambiance mi-glaçante, mi-poétique.
Sauf que, chose que je n’attendais pas : il s’agit d’un livre d’action. Pour sauver l’océan, le capitaine du vaisseau fantôme qui kidnappe Oural est bien déterminé à se battre : il lui faut récolter des âmes humaines et les offrir en sacrifice. L’action marche parfaitement bien, la tension est au rendez-vous, il y a des scènes de combat épique contre les marrées fantômes et pour récupérer des âmes humaines, des passages déchirants, un capitaine de vaisseau moralement gris, des relations complexes (et amoureuses) entre Oural et le capitaine… J’ai passé un excellent moment de lecture.
N’empêche que je ne peux m’empêcher de trouver la portée écologique du texte diminuée par cette débauche d’action : il me semble que c’est l’individualisme, l’idée même qu’il est acceptable de sacrifier certaines personnes pour en sauver d’autres, qui cause des désastres écologiques. Comment le salut pourrait-il venir des mêmes travers ?
Partie bonus : représentation et structures narratives
Un point que j’aimerais aborder pour conclure sur l’importance de parler des structures : souvent, quand je vois passer des critiques de livres « problématiques », cela concerne des points liés à la représentation : Tel livre ne serait pas on bon livre, car il ne donne pas une bonne représentation de [insérer catégorie minorisée].
Mais à bien y réfléchir, je pense qu’aucune représentation n’est mauvaise en soi. C’est la répétition d’une représentation similaire qui finit par le devenir.
Souvent, quand on dit « c’est une mauvaise représentation », on veut dire « cela donne une image clichée/néfaste de telle ou telle identité », sauf que des personnes réelles qui donnent une mauvaise image de telle ou telle identité… ben ça existe. On ne va pas les effacer.
Dans Dans la maison rêvée, Carmen Maria Machado raconte sa relation toxique avec une autre femme. Le livre parle des violences psychologiques subies, mais aussi de la difficulté à en parler quand la relation toxique est spécifiquement lesbienne. Elle écrit :
Après toutes ces années, si je ne devais lui dire qu’une seule chose, ce serait : « mais putain, arrête de donner une mauvaise image de nous. »
[Carmen Maria Machado, Dans la maison rêvée, p.198]Il n’est pas déplacé de dire à un artiste qu’il a une responsabilité dans le fait de choisir qui endosse le rôle du méchant, mais ce n’est pas si simple.
[…] Nous méritons que nos méfaits soient représentés au même titre que notre héroïsme, car lorsque nous refusons à un groupe la possibilité même de ses méfaits, c’est son humanité toute entière que nous nions.
[Carmen Maria Machado, Dans la maison rêvée, p.86]
Pour moi, les critiques de « mauvaise représentation » sont bien souvent des critiques « de niveau 1″ : quand on remarque des choses qui nous mettent mal à l’aise, mais qu’on n’a pas forcément assez d’expérience ou de recul pour analyser plus en détail (par exemple parce qu’on n’est pas directement concerné par la problématique abordée).
Par exemple, quand on fait le recensement des sorties LGBTQ+ pour fantastiqueer, on n’applique aucun jugement de valeur sur la qualité des livres : on les recense tous (il y a la section « avis » pour dire ceux qu’on recommande ou pas). Aussi, je me rends bien compte que je n’ai aucun problème à ajouter des titres hyper douteux où la représentation LGBT semble dès la 4e de couv plus relever de la fétichisation que d’autre chose… et je suis par contre super réticente quand il s’agit d’ajouter un titre qui m’a l’air raciste.
Pour donner un exemple peut-être plus concret, j’avais lu Les Tentacules de Rita Indiana à sa sortie en France. Dans ce roman de science-fiction, on suit notamment plusieurs artistes en résidence dans les Caraïbes, l’un d’entre eux étant un homme noir sexiste, et raciste (racisme internalisé) et désagréable. J’avais trouvé le livre fort intéressant par de nombreux aspects, mais je ne savais pas quoi penser de la représentation de ce personnage. Or nous avons reparlé de ce livre lors de l’interview :
Ketty : Je suis Antillaise donc j’ai retrouvé plein de trucs de l’ambiance des Antilles. Et donc ça n’a pas fini de décanter, je sais pas. Je suis contente de l’avoir lu.
Moi : Mais tout le racisme intériorisé, je voyais pas où ça allait…
Ketty : Tu voyais pas où ça allait parce que ce racisme intériorisé ne servait pas à porter un message sur les races ou les gens. C’est simplement la matière des personnages. Quand tu vis en République dominicaine et que t’as telle ou telle apparence, ce n’est pas rien, c’est une caractéristique, mais en fait c’est pas le sujet. Donc effectivement, ça sert pas un dessein particulier, ça peut paraitre de trop : à quoi ça sert de se foutre de la gueule du grand noir là, si c’est pas pour le buter à la fin ? Bah non, c’est pas le but.
Tout cela pour dire : on peut parler de mauvaises représentations, bien sûr, il y en a. Seulement je pense qu’il faut garder à l’esprit deux choses :
La première, c’est que l’analyse des « mauvaises représentations » (je mets des guillemets, car cela me parait fort binaire la dichotomie bonne/mauvaise) sera sans doute plus intéressante si elle est statistique : que l’on cherche les récurrences de tel ou tel cliché et l’image globale que cela finit par véhiculer. À ce compte, si on décortique une œuvre en particulier, ce sera à titre d’exemple.
La deuxième, c’est qu’au-delà de « tel personnage est-il cliché ? », ce qui va déterminer si oui ou non cela vaut la peine de le pointer du doigt, c’est tout le contexte autour, et notamment donc : la structure narrative.
Le corolaire de tout cela, c’est que les « bonnes représentations » ne font pas tout.
Pour moi, penser la diversité des représentations comme étant l’aspect le plus important d’une histoire progressiste est ce qui rend la littérature dite « Young adulte » si décevante à mes yeux : ce genre me semble avoir émergé en réponse aux gouts littéraires d’adultes (dont j’ai moi-même fait partie pendant longtemps) ayant grandi avec une littérature jeunesse riche, montrant des personnages de tous horizons (bon à mon époque c’était surtout « au moins y’ avait des personnages féminins », mais une diversification est à l’œuvre) vivre des aventures. Une fois adulte, ce public peine à trouver sa place dans une littérature trop souvent encore dominée par des héros masculins, blancs, virils (avec tout ce que ça implique de sexisme).
Aussi, rien que le fait d’avoir, pour une fois, ne serait-ce que ça, une héroïne plutôt qu’un héros : c’est un bol d’air.
Mais de plus en plus souvent : cela ne me suffit pas/plus (notez que c’est pas forcément grave en soi, de me rendre compte que je suis plus la cible).
Je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo (en anglais) qui explique assez bien mon ressenti en se focalisant sur la mode des dystopies « young adults » dans la lignée de Hunger game. Dans « The rize and fall of tean dystopias », la youtubeuse Sarah Z explique ce qui selon elle diffère entre les dystopies destinées à des adultes et celles pensées pour un public plus jeune : les deuxièmes prennent une tournure plus personnelle.
En effet, il est difficile d’expliquer le fascisme ou le capitalisme à un ado, mais l’identification constituant un premier pas, on peut lui raconter des histoires plus personnelles qui sont de l’ordre de ce qu’il vit déjà dans sa vie quotidienne, de type « et si le gouvernement mettait en place un truc pour choisir à ta place le meilleur couple, et que du coup tu pouvais pas sortir avec Thomas alors que c’est obviously le plus beau garçon de ta classe ? ».
La plupart des romans YA dystopiques qui ont fait suite à Hunger Game n’avaient rien de spécial à dénoncer. Souvent, le gouvernement était en chasse de gens qui étaient « spéciaux » (par exemple en raison de pouvoirs psychiques). Toutes ces histoires finissaient par avoir des fins simplistes où les problèmes se résolvaient parce que les héros·ïnes battaient le méchant™.
Dans Divergente par exemple (une des séries de livres « post-Hunger game » les plus populaires) l’héroïne est… divergente, ce qui veut dire qu’elle a… plusieurs traits de personnalité en même temps (bref comme tout le monde quoi), et c’est pour cela qu’elle est pourchassée par le gouvernement. Le système de caste qui trie les gens en fonction de leur trait de personnalité n’est pas remis en question : le problème, c’est seulement qu’une des factions devient maléfique (il faut les vaincre) et que les divergents cool-kids sont pourchassés (il faut faire stopper ça en prouvant que les divergents sont… supérieurs à tout le monde parce qu’iels sont… génétiquement purs ? Ouais bad take).
Au final, l’histoire a des allures de dystopie (un monde avec un système pourri et un héros qui lutte pour s’en sortir), mais c’est plus un prétexte à l’action et à la mise en avant d’un. e héro. ïne badass.
Dans un autre registre (fantasy adulte cette fois), Le Prieuré de l’oranger est un roman de Samantha Shanon qui a été beaucoup loué pour la qualité de ces représentations : C’est un monde de fantasy avec des dragons et une romance lesbienne centrale, il y a un reinaume plutôt qu’un royaume, les personnages féminins ne se font pas agresser sexuellement à tous les coins de rue… que demander de plus !
Le roman fait mille pages que je n’ai pas vues passer, j’étais totalement investie et impressionnée de voir les différents éléments de l’intrigue s’aligner en un tout cohérent. Vraiment : je ne regrette pas de l’avoir lu.
Oui sauf qu’au-delà de ça… les personnages principaux n’ont de l’importance que parce qu’iels sont désigné·es par des prophéties ou descendant·es d’une lignée puissante au pouvoir depuis des siècles, quant au reinaume : la reine n’existe que pour engendrer son héritière. Cela ne me parait pas anodin, politiquement.
Alors à tout prendre : je préfère Les Tentacules, ses n**** à longueur de paragraphes et son héros trans qui ne se genre au masculin qu’à la seconde où il obtient l’équivalent science-fictif d’une chirurgie de réassignation sexuelle.
Bref, la représentation ne fait pas tout. Loin s’en faut. Sans compter qu’un livre « sans représentation » peut fort bien être réapproprié.
Saul : J’ai pas forcément cette idée que l’écriture qui va le plus me transporter c’est celle qui va être la plus anormale. Je crois qu’il y a aussi un mystère de ce que nous fait l’écriture. Il y a des rencontres avec des textes… C’est pour ça aussi que c’est intéressant qu’il y ait des lectures queers. Les lecteurices sont pas mal libres quand même. C’est très bateau ce que je vais dire, mais la part de co-construction de l’œuvre par les lecteurices est quand même importante.
(Cadeau pour illustrer : cette vidéo de la chaine youtube AreTheyGay volontairement dans la suranalyse une figure aussi hétéronormative que Barbie : « Overanalyzing the Barbie movies with a queer Marxist theory ». L’idée c’est que, justement parce que l’hétérosexualité est considérée comme allant de soi, il n’est même pas nécessaire de la montrer. En conséquence : les films Barbie se concentrent sur des amitiés entre femmes qu’il est d’autant plus facile de relire comme des romances lesbiennes que les amitiés féminines sont rarement représentées. La conclusion c’est : est-ce que Barbie est gay ? Comme tu veux. C’est un jouet, le principe c’est que tu en fais ce que tu veux.)
Bien sûr, un débat « est-ce mieux d’avoir de la diversité dans les personnages, mais une structure classique, ou une structure intéressante, mais portée uniquement par des personnages cishetéro blancs valides ? » serait absurde. En fait, les deux marchent ensemble. J’insiste autant sur les structures dans un contexte où elles sont trop souvent négligées.
Saul : C’est aussi à ça que ça sert de sortir du schéma du héros : les personnages sont plus que des instruments. À partir du moment où il n’y a pas une espèce de grand projet dans le roman, « c’est ça l’enjeu : il faut trouver la pierre magique ou empêcher l’astéroïde de s’écraser sur la terre », d’un seul coup, les gens existent autrement que comme accessoires à une action principale.
Sabrina : Je suis tributaire moi aussi d’un certain nombre de structures inconscientes. C’est-à-dire que je vais utiliser des structures assez larges d’évasion du prisonnier, ou de la quête pour trouver un objet magique et se trouver soi-même. Mais mon travail consiste, en temps réel quasiment, à subvertir et à détruire toutes les structures narratives qui potentiellement émergeraient dans mon récit. À partir du moment où je vois une structure narrative qui émerge dans mon récit, je la laisse se déployer un moment donné pour qu’on puisse comprendre quel est mon point de départ, mais mon but c’est de la détruire en fait.
Mon processus de destruction de la structure narrative pour moi fait partie intégrante de la création poétique. C’est-à-dire que tu peux poser des intentions structurelles qui ne sont que ça : que des intentions.
Ça marche aussi pour les clichés, c’est-à-dire pour les figures formelles, mais je trouve que là où c’est vraiment fort c’est les structures narratives : C’est pas simplement de dire « ah vous croyez qu’en fait la princesse c’était une femme, mais en fait c’est un homme ! », c’est pas de ça dont on parle, c’est littéralement de dire qu’en fait le mec qui veut aller sauver la princesse, il va finir par baiser son cheval dans un marécage, il va rencontrer une grenouille qui va lui expliquer la vie, et il va finir par lui demander de lui lécher le dos. Voilà. Un truc dans ce genre-là.
Par ailleurs, bonus : quand on décentre la critique (positive ou négative) des questions de représentation pour s’intéresser davantage aux structures, alors on s’éloigne des préoccupations liées aux identités des uns et des autres (des personnages et des autaires) pour parler de ce qui est vraiment intéressant : le contenu du livre.
Parce qu’en réalité, les tables rondes sur « la diversité » sont comme les débats « jardiniers ou architectes » : ça tourne en rond.
Ketty : J’ai refusé récemment de faire ENCORE une table ronde sur la diversité. La question que je me suis posée c’est « est-ce qu’ils vont la faire quand même et trouver quelqu’un qui sera content de la faire ? Ou est-ce qu’ils vont comprendre que c’est peut-être une bonne idée de faire attention à la diversité quand tu fais ta liste d’invités pour ton évènement, et que après, une fois que les gens sont là, tu leur fous la paix. Tu peux leur poser des questions sur les raisons pour lesquelles ils sont là : si c’est un illustrateur, qu’il parle de ces illustrations. »
J’ai répondu : si le problème de la diversité est si important, faites une table ronde entre personnes blanches, et première question : « Est-ce que l’entre-soi nous dérange ? » Si la réponse est non, ben c’est fini, y’ a plus de tables rondes. Si la réponse est oui : « Que pouvons-nous faire autrement ? »… Plutôt que de venir me chercher moi. Qu’est-ce que tu veux que je dise ? « Ah c’est horrible d’être discriminée. Humm. Oh oui oui oui. Mais vous, vous êtes gentils : vous m’avez invitée à parler donc je ne suis plus discriminée. Le problème est réglé. » C’est bon, ça va… On a déjà joué à ça.
On parlait d’avoir plusieurs caractéristiques pour les personnages, mais on côtoie des personnes qui sont pas capables de le faire pour des individus. La marge de progression est grande : comment tu peux accéder à des personnages qui ont plusieurs caractéristiques si tu n’arrives pas à voir tes semblables comme étant capables d’en avoir plusieurs ? C’est un peu déprimant quand on y pense.
La gentrification des structures
Ou pourquoi la littérature est plus riche qu'on ne pense
Cela étant dit, je ne suis pas la première personne à parler de l’importance des structures narratives et des idées qu’elles véhiculent jusque dans l’inconscient collectif. Ursula LeGuin le disait déjà avant ma naissance, en 1986, dans son fameux essai La Théorie de la fiction panier.
C’est l’histoire qui fait la différence. C’est l’histoire qui me cachait mon humanité, l’histoire que racontaient les chasseurs de mammouth à propos de raclée, de viol, de meurtre, à propos du Héros. L’histoire merveilleuse et empoisonnée du Botulisme. L’histoire-qui-tue.
Il semble parfois que cette histoire touche à sa fin. Nous sommes plusieurs à penser, depuis notre coin d’avoine sauvage, au milieu du maïs extra-terrestre, que, plutôt que de renoncer à raconter des histoires, nous ferions mieux de commencer à en raconter une autre, une histoire que les gens pourront peut-être poursuivre lorsque l’ancienne se sera achevée. Peut-être. Le problème, c’est que nous avons tous laissé nos êtres devenir des éléments de l’histoire-qui-tue, et que nous pourrions bien nous éteindre avec elle. C’est donc avec un certain sentiment d’urgence que je cherche la nature, le sujet et les mots de l’autre histoire, celle qui jamais ne fut dite, l’histoire-vivante.
[Ursula Le Guin, Théorie de la fiction panier]
Mais si nous sommes plusieurs, que nous l’étions par le passé et que nous le somme encore : d’où vient que l’on peine encore tant à trouver ces « histoires vivantes » donc Le Guin parlait ?
La première raison, la plus évidente, est que nous sommes toustes influencé·es par le reste de la littérature/pop culture.
Sabrina : Et puis tout ça c’est informé par tout ce que j’ai lu, tout ce que j’ai emmagasiné dans ma vie et bouffé de structures. Parce que je suis bourrée de structures ! J’ai bouffé je sais pas combien de bouquins, de films, de jeux vidéos dans ma vie quoi. Tout ça, toutes ces situations, elles existent déjà dans ma tête. J’ai juste à piocher dans des situations infinies, des patterns que les gens connaissent déjà probablement.
Ketty : Ceci dit, si je réfléchis, je crois que Eugénie grandit doit pas être très éloigné du monomythe. Si je te résume : c’est cette gamine (bon on a pas ce moment où tout va bien parce que tout va pas bien, elle est ado donc ça ne peut pas aller) qui s’interroge sur « qu’est-ce que je suis ? » et « qui je suis ? » parce qu’elle a toujours été à part. Et elle découvre qu’elle est a été fabriquée. […] Elle elle va essayer d’en savoir un peu plus donc il va y avoir des obstacles, et il va y avoir là-dedans sa rencontre avec sa vocation. […] Et donc effectivement tout s’emballe vers la fin où on ne sait pas ce qui va se passer… et il se passe un truc. Purée je l’ai fait ! Sans faire exprès ! J’suis désolée ! [rire]
Ce que je trouve intéressant, là-dedans, c’est que malgré tout en France, nous n’avons pas comme aux États-Unis de réelle possibilité d’étudier l’écriture créative à la fac comme on peut apprendre d’autres pratiques artistiques aux Beaux-Arts, dans des écoles de cinéma ou en conservatoire. Il y a bien trois ou quatre formations qui ont ouvert, mais elles ne sont accessibles qu’au niveau master et le plus ancien date seulement de 2010.
En vérité, c’est un avantage et un inconvénient : d’un côté, ça participe au fantasme éculé de l’écrivain romantico-dépressif dont les mots jaillissent, poussé par une inspiration créatrice presque divine que toute forme de considération matérielle, de la possibilité de se former à l’existence d’un statut financier, viendrait entacher. Mais d’un autre côté, cela laisse aussi une forme de liberté de choisir par quoi on a envie d’être influencé·es.
Ketty : Moi je suis totalement autodidacte de l’écriture. Je ne me suis pas inventée toute seule dans mon coin, j’ai beaucoup lu, donc j’en ai appris des choses que j’ai lues. Ça a certainement nourri un gout pour certaines structures de manière inconsciente. Mais j’ai pas appris de technique d’écriture. Et j’en suis plutôt contente. Je me suis intéressée après coup à comment c’est censé marcher, mais je suis contente d’avoir exploré toute seule et d’avoir trouvé des formes qui me plaisent avant d’avoir eu des leçons sur voilà comment il faut faire. J’imagine que ça m’aurait un peu coincée. L’écriture en France c’est juste un truc qu’est sensé être magique et si t’y vas avec un mode d’emploi, p’t’être tu passes à côté de ce qui te convient réellement. Et quand t’es hors norme dans le reste de ta vie, ça peut être pas mal de… « fin voilà : de trouver ce qui te convient réellement.
Saul : Moi pareil : j’ai pas étudié pour ça, je fais pas d’ateliers d’écriture, j’ai pas fait de formation… et j’y trouve une grande liberté en fait. Après je suis persuadé que dans mon écriture, tout simplement comme du disais Ketty, à force de lire, de voir des films, y’a forcément des principes narratifs qui infusent quelque part dans ma tête. Et c’est sûr que je dois en reprendre. Je trouve qu’il ya une forme de liberté aussi à être autodidacte, c’est clair. Ça t’autonomise de pleins de schémas, de plein de recettes. Ptet que j’y reviendrai plus tard, ptet que ça m’intéressera d’être moins dans l’intuition et de comprendre ce que je fais. Mais pour le moment ça me va assez bien de faire de la prose sans le savoir.
J’entends souvent dire qu’il n’y a pas assez d’autaires professionnel·les en France, au sens où les jeunes autaires qui proposent leurs textes pour la première fois à des maisons d’édition n’ont travaillé qu’en solo ou avec les conseils d’une poignée de bêta lecture. Il y a des enjeux propres à l’édition qu’iels ne connaissent pas et sur lesquels il faut les former… Et ensuite, une fois qu’iels ont publié leurs premiers romans, iels risquent de se faire rattraper par les enjeux économiques : le marché du livre francophone est petit, le marché du livre d’imaginaire francophone l’est plus encore, même si l’on touchait 100 % des revenus générés par la vente d’un livre (dans la pratique, on est content·es avec 10 %), on ne s’en sortirait pas.
Mais en même temps, je pense à cet extrait de l’essai de Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, dans lequel elle évoque le tout début des formations de “creative writing” aux États-Unis :
J’admets avoir envisagé d’obtenir un MFA [Master of Fine Art, diplôme de Beaux-Arts] quand j’ai appris ce que c’était. Lorsque j’en entendis parler pour la première fois, j’avais déjà publié deux livres, mais alors que le monde de l’art commençait à se gentrifier autour de moi je réalisais que le MFA était nécessaire à la socialisation et pour se faire des contacts. […] Je suis allé passer mon premier jour en classe. […]Après le cours Grace [Paley, l’enseignante] me regarda.
“Viens dans mon bureau, me lança-t-elle avec son accent New-Yorkais non restitué ici. ‘Écoute, me dit-elle lorsque la porte fut fermée. Tu es déjà une vraie auteure. Vraiment. Tu n’as pas besoin de suivre ce cours. Rentre chez toi.
Je partis donc et ne revins jamais. Elle m’avait sauvée.
[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, p.96]
Alors au fond, c’est peut-être une force : qu’en France la norme soit toujours de débarquer de nulle part avec nos histoires cheloues.
Et tout cela m’emmène à la deuxième raison qui fait perdurer les récits classiques. C’est lié à ce que Sofia Samatar disait plus haut (la définition facile d’un archétype, c’est simplement quelque chose qui existe depuis longtemps) : il y a une forme de gentrification, c’est-à-dire une réappropriation par la norme de ce qui, à l’origine, est produit par la marge.
Les véritables artistes — ceux·celles qui inventent plutôt qu’ils·elles ne reproduisent — ont besoin de la contre-culture comme espace de jeu.
[…] L’invention formelle n’est pas intrinsèquement progressiste, comme nous l’ont appris les clips vidéos, l’infographie ou les samples. L’invention formelle poursuit un but radical lorsqu’elle exprime des points de vue non conventionnels, c’est-à-dire lorsqu’elle étend le registre de l’expérience humaine. Bien que de nombreux·euses hétérosexuel·les évitent de parler du destin, de la fatalité romanesque, du mariage ou de la parentalité, ces structures immédiatement reconnaissables et éculées sont la base de la représentation dominante. En d’autres termes, la plupart des hétéros bourgeois connaissent déjà le script auquel leur vie est censée se conformer avant même qu’elle n’ait commencé. Les choses étaient différentes pour les queers d’avant l’assimilation. Nos vies étaient des œuvres bizarrement structurées en dehors de toute prédétermination, des histoires inconnues qui n’avaient jamais été racontées. La culture dominante nous a appris que nous étions des parias esseulé·es, puis a fait tout son possible pour que cela devienne la réalité. C’est du conflit entre notre détermination à exister véritablement en pleinement en tant que personnes, et notre lutte à l’encontre des fausses histoires propagandistes, ou des silences encore plus puissants, qu’est née la culture queer.
[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, p.79]Beaucoup d’artistes que je connais et qui m’éduquèrent étaient des parias. Ils·elles […] envoyaient se faire foutre les valeurs de la culture dominante. Tout cela leur a permis d’initier de nouvelles idées artistiques plus tard appréciées par tous·tes. Beaucoup d’entre eux·elles moururent ou furent marginalisé·es. Et ils·elles furent en partie remplacé·es par des personnes éduquées et diplômées dans des institutions hors de prix. [Ces] étudiants commençaient à produire à l’intérieur d’un genre désormais établi, qualifié ‘d’expérimentale’. Cela n’avait plus rien d’expérimental, il s’agissait plutôt d’un ensemble de paradigmes conventionnels, inventés par leurs professeur·es — dont beaucoup n’avaient pas de MFA.
[Sarah Schulman, La Gentrification des esprits, p.93]
L’idée c’est que les innovations (formelles, structurelles, etc.) si elles gagnent en popularité, finissent par ne plus être des innovations. Or à force d’être répétées, y compris par des personnes qui sont moins marginalisées/radicales dans leurs démarches, ses ex-innovations finissent par devenir à leur tour des morceaux de la structure dominante.
Saul : Le cliché c’est un archétype qui a dégénéré.
Mais cela va plus loin que cela, ce n’est pas seulement une question de ‘les copies sont moins bien que l’originale’. Ce qui arrive aussi, c’est qu’alors qu’une œuvre entre dans l’inconscient collectif, beaucoup de gens se mettent à ‘connaitre l’œuvre’ sans l’avoir vraiment vue/lue.
J’ai réalisé ça alors que (et je ne m’y attendais pas) la moitié·es de mes invités se sont mis à me parler de leur amour pour Tolkien.
Sam : Je suis vraiment très fan de Tolkien, et il ne décrit pas les batailles. Je voulais faire la même chose dans mon propre livre. L’idée, c’est que les batailles et la guerre sont sales, il n’y a pas de raison de les présenter comme héroïques ou significatives. Or il n’y a qu’un seul moyen d’éviter cet écueil : ne pas les montrer. Car même avec une description qui montre l’horreur des combats, il y a toujours un risque que les lectaires les trouvent chouettes ou fun.
Sabrina : Je suis une grande fan de Tolkien moi tu sais, et Tolkien il a dit quelque chose d’extrêmement important sur la construction de monde : elle se fait avec des mots, avec des langues. Elle se fait pas avec de grands paramètres comme les dieux et autres machins. C’est un by-product ça, un truc de jeu de rôle, pas de littérature. La création de mondes littéraires se fait avec des mots.
Mais qu’est-ce que l’inconscient collectif a retenu du Seigneur des anneaux (porté par des gens comme moi qui n’ont, en fait, jamais lu les livres) : du folklore de créatures « de fantasy » (Hobbits, Elfes, Nains, Hunt, Humains, Dragons ou Magiciens) lancées dans une quête épique pour détruire l’anneau unique, des scènes de batailles gigantesques tournées à grand renfort d’effets spéciaux. On retient Gimly et Legolas qui font un concours de qui tue le plus d’ennemis, de qui est le plus héroïque des guerriers.
Du côté science-fiction, il est arrivé sensiblement la même chose avec Le Cycle des robots d’Asimov : il avait pour but de proposer une histoire différente de celles trop de fois répétées où, tel le monstre de Frankenstein, la créature (les robots) développe une conscience et se rebelle contre le créateur (les humains). C’est ce qu’il explique dans la préface du livre.
Je commençai, en 1940, à écrire des histoires de robots de mon cru… Jamais, au grand jamais, un de mes robots ne se retournait stupidement contre son créateur sans autre dessein
que de démontrer pour la énième fois la faute et le châtiment de Faust.
Sottises ! Mes robots étaient des engins conçus par des ingénieurs et non des pseudo-humains créés par des blasphémateurs. Mes robots réagissaient selon les règles logiques implantées dans leurs « cerveaux » au moment de leur construction.
[Isaac Asimov, préface au Cycle des robots]
Les nouvelles du Cycle des robots sont construites de façon tout à fait atypique, si on les compare au monomythe de Campbell : il n’y a pas de héros, pas d’antagoniste, pas vraiment d’action, aucune transcendance de type « j’ai vaincu les obstacles et j’en reviens changé ». Il n’y a que des énigmes logiques : les robots sont simplement soumis à trois lois, qui parfois se contredisent, alors ils tournent en rond.
Dans l’une des nouvelles, un robot ne peut avancer que s’il y a un humain qui le pilote, or il doit se rendre dans une zone radioactive qui mettrait le pilote en danger. Alors le robot est tiraillé entre deux commandements « ne jamais mettre un humain en danger » et « toujours obéir aux humains sauf si cela entre en contradiction avec la loi précédente ». Il ne peut plus avancer (cela mettrait l’humain en danger) ni reculer (il désobéirait).
L’histoire consiste simplement à comprendre dans quel paradoxe le robot est coincé.
Mais l’adaptation cinéma (I, robot) raconte… l’histoire d’une intelligence artificielle qui se rebelle contre les humains (c’est présenté sous la forme « j’ai constaté que vous faites n’importe quoi, vous les humains, et donc je suis arrivée à la conclusion que tous vous exterminer est la meilleure façon d’y parvenir »). Même au niveau des personnages : Susan Calvin qui était dans les nouvelles une vieille femme acariâtre qui préférait la compagnie des robots à celle des humains devient l’intérêt romantique du héros.
Dans ces deux exemples, le contresens sur la nature de l’œuvre se fait au moment de l’adaptation au cinéma. Mais c’est un processus qui peut arriver beaucoup plus vite. Dans sa dernière publication, L’Évangile selon Myriam, Ketty Steward propose un texte à mi-chemin entre le roman et le recueil de nouvelles. On nous présente brièvement Myriam, une jeune fille vivant dans un futur post-apocalyptique. Son rôle, au sein de sa communauté consiste à écrire un évangile à partir des bribes culturelles qui ont survécu au passage du temps. Mais l’essentiel du texte, ce n’est pas la vie de Myriam (qui meurt au début du roman), c’est le contenu même de ce qu’elle a écrit : des réécritures de contes, de passages bibliques ou de mythes dont la juxtaposition révèle des affinités thématiques.
Ketty : Plusieurs critiques [de L’Évangile selon Myriam] ont essayé de donner un peu d’héroïsme à Myriam alors que, quand même, elle grille au début. J’ai fait exprès de la faire crever direct. Donc laissez-la tranquille ! Mais non, il faut l’héroïser, dire qu’elle crée de nouvelles vérités, parce que c’est très compliqué visiblement, quand on a l’habitude de lire certains types de bouquins, de s’imaginer qu’on est face à quelque chose d’autre.
« Oui, mais du coup, ce qu’elle essaie de…
— Bah non, elle essaie probablement de survivre, juste. Il faut bien qu’elle fasse un truc et elle sait rien faire d’autre qu’écrire. C’est tout.
— Oui, mais elle réussit !
— Oui… tellement qu’elle est plus là pour en parler, s’tu veux, donc… »
Il y a une appétence quand même pour cet héroïsme, et une envie de le voir même quand on le met pas. Je ne me suis pas contentée de ne pas le mettre : je l’ai un peu brisé le machin, dans l’œuf. Mais non. On en veut quand même. Fais-nous rêver.
Alors je ne peux m’empêcher de me demander : combien y en a-t-il, des livres qui tentent de faire des choses, mais que l’on ne voit pas quand bien même on a le nez dessus ?
Le neuf n'existe pas
Ou alors, il est partout
Pour faire ma liste d’invité·es et de questions, j’ai réfléchi aux romans qui m’avaient marqué ces dernières années et à leurs points communs. Il m’apparaissait que la plupart se focalisaient sur leurs personnages plutôt que sur l’intrigue. Quelque chose de cet ordre :
Sofia : La définition de ce qu’est « un évènement », de ce que « quelque chose arrive dans le temps » veut dire, peut énormément varier. Typiquement, particulièrement en fantasy et en héroïc fantasy (qui sont les genres littéraires de mes romans), je crois qu’on a tendance à attendre que ces évènements soient physiques. Mais beaucoup de choses peuvent arriver à l’intérieur d’une personne. « Penser » peut être un évènement. Les processus de réflexion sont des évènements. Les émotions également. Et parfois, ces évènements internes sont plus puissants et ont un effet plus durable sur les gens que des contingences externes et physiques. Alors j’aime quand cela est dépeint de manière plus directe et détaillée dans la littérature de fiction, en fantasy.
Seulement, comme me l’a justement fait remarquer Sam Mariem Corrèze quand je lui ai demandé ce qu’iel pensait d’une action centrée sur les personnages d’avantages que sur l’action : se centrer sur les personnages, c’est un peu le propre du roman.
Sam : Ta question est intéressante parce que de mon côté, j’ai toujours considéré que les romans étaient justement un type de littérature centrée sur les personnages. C’est ce j’ai appris à l’école : « Flaubert n’écrit pas des histoires, il écrit des personnages ! ». Cela me plaisait : l’idée d’écrire des personnes imaginaires, que tu puisses créer quelqu’un, et qu’il/elle aura l’air assez réel et tangible pour que les gens soient prêts à lire un roman entier sur sa vie. Je ne sais pas si j’y suis parvenu, mais je crois que c’était cela, mon objectif : écrire l’histoire d’un personnage. L’action et les décors sont secondaires, ce qui compte, c’est par quelles émotions et challenges passe le personnage.
En fait, il faut surement replacer les choses dans leurs contextes : j’ai beaucoup parlé d’Ursula LeGuin (comment parler de structures narratives sans au moins évoquer sa théorie de la fiction panier), mais une chose qui m’avait marqué à la lecture de son recueil d’essai Le langage de la nuit, c’est à quel point elle parlait de la SFFF de son temps, qui, le genre évoluant, n’était plus tout à fait la SFFF du mien. Je me souviens par exemple qu’un des textes expliquait pourquoi à son avis, la « vraie » fantasy se devait d’être écrite dans un langage particulier, car employer un vocabulaire et un phrasé contemporain équivaudrait à planter sa tente sur une aire de camping à côté d’une autoroute et appeler ça du trekking sauvage (la métaphore est d’elle).
La science-fiction, à l’époque de LeGuin, était souvent écrite dans un style tranchant qui rappelait la rigueur des publications scientifiques. Les personnages étaient des scientifiques qui, souvent, n’avaient pas tellement de vie sociale en dehors de leurs travaux.
Sam : Quand j’ai découvert Ursula LeGuin, je me suis dit « oh ! Alors j’ai le droit d’écrire des histoires qui n’auront de sens que pour moi et pour les personnes qui voudront bien trouver du sens à mes textes ? » Si tu lis Ursula LeGuin juste pour le plaisir ou te vider la tête, tu ne comprendras pas. Cela ne veut pas dire que tu es bête, seulement, il faut vouloir trouver un sens à ses histoires, qui vont à contre-courant de ce dont on a l’habitude.
Aussi, en tant qu’auteur, j’ai l’impression qu’elle écrit comme une anthropologiste, ce que j’apprécie énormément. Elle écrit à propos d’autres cultures avec révérence et curiosité.
Et en vérité, si l’on s’est habitué·es à ce type de protagonistes en science-fiction, cela n’en reste pas moins un moyen de subvertir le monomythe : il y a des obstacles techniques sur la route des scientifiques, mais ce ne sont pas des obstacles que l’on franchit en se battant, il faut au contraire se montrer attentif, à l’écoute du monde autour. Quant à la révélation, ce n’est pas le personnage qu’elle fait grandir, c’est l’étendue des connaissances collectives.
Depuis, la SF a évolué, ce qui veut dire qu’elle s’est diversifiée : certains livres continuent de mettre en scène des scientifiques :
Sofia : Renee Gladman a écrit la tétralogie Ravicka. Le premier tome s’appelle Voyage à Ravicka. L’histoire est celle d’une linguiste qui se rend dans la ville fantastique de Ravicka […]
J’adore ces livres parce que, d’abord, ils racontent l’histoire d’une chercheuse. Pas un sorcier, pas un guerrier, une linguiste. Et aussi, parce que la langue est si belle (Renee Gladman est poète, elle est peu connue comme autrice de fantasy, mais très connue en tant que poète). L’attention
portée à la langue et à la communication dans cette société vraiment différente est incroyable. Par exemple, il y a une grande importance de la gestuelle, ce qui nécessite un apprentissage, pour nous et pour la narratrice.
Pour ma part, je garde un excellent souvenir d’Annihilation de Jeff VanderMeer, roman dans lequel l’héroïne est une biologiste si fascinée par les mutations de la zone qu’elle part explorer, que tout ce
qu’elle décrit, qui en d’autres circonstances serait purement horrifique, m’est apparu comme beau, presque doux.
D’autres explorent d’autres voies, plus romanesques, centrées sur les émotions des protagonistes et leurs relations sociales (en amitié, en amour, en collectivité, etc.).
J’ai déjà parlé d’Asimov, mais il me semble que l’adaptation en série de Fondation témoigne bien de cette évolution : dans les livres, les personnages sont tous des hommes scientifiques qui parlent de façon très académique de la psychohistoire. Certains changements opérés par la série visent à mettre plus d’action, comme le fait que Salvor Hardin passe de « maire qui résout les conflits par la négociation » à « gardienne qui résout les conflits en se battant ». Mais d’autres me semblent relever d’une volonté d’humaniser les personnages. Par exemple, l’assistant de Hari Seldon, Gaal Dornick n’est plus seulement mathématicienne hors pair, elle est aussi issue d’un certain contexte social (elle est née sur une planète où les sciences sont interdites), elle a une vie sentimentale (une romance avec le bras droit d’Hari Seldon), elle tombe enceinte, etc.(NB : il y a aussi une volonté de diversifier le casting puisqu’aussi bien Salvor Hardin que Gaal Dornick sont jouées par deux femmes noires, alors que c’était des hommes dans les livres).
Il me semble qu’un des essais du Langage de la nuit témoigne de l’évolution du genre de la SF : Dans Science Fiction and Mrs Brown, LeGuin se demande s’il serait possible de rencontrer de véritables personnages, à l’instar de la Mme Brown décrite par Virginia Woolf dans son essai M. Bennett et Mme Brown. Quelqu’un qui a l’air vrai. LeGuin commence par dire qu’elle n’en est pas sûre avant de raconter sa première rencontre avec une « Mme Brown » dans un roman de science-fiction.
Aujourd’hui, la plupart de mes romans de SFFF préférés sont pleins de personnages, de « Mme Brown ». On pourrait presque dire qu’ils se démarquent d’une SFFF plus ancienne en faisant… exactement ce qui est attendu d’un roman ?
Le neuf n’existe pas. On écrit toujours à partir du contexte qui nous a nourris.
Quand, je préparais cet article, je me suis livrée à un exercice de science-fiction tout particulier : imaginer ce que ça ferait si la structure narrative majoritaire n’était pas celle du monomythe.
Oasis Nadrama m’avait par exemple donné le lien vers A brief history of Bigencenryin, une œuvre sous la forme d’une « page Wikipédia » racontant le contexte de création d’une série imaginaire. Cette série aurait été écrite par des Aliens de Pasaru, une civilisation où les histoires existeraient sans qu’il y ait de notion de personnage (jusqu’à ce que, inspirés par les gens de la terre, des auteurs écrivent la saga Bigencenryin).
Mon idée, dans les grandes lignes, était d’imaginer des archétypes dans lesquels je me serais plus reconnue.
Seulement de deux choses l’une :
Soit cela revient simplement à écrire des personnages, dans la mesure où ces derniers ne sont jamais tout à fait des personnes :
Ketty : Y’ a toujours une simplification, y’ a toujours quelque chose qui relève d’une essentialisation du personnage. Ce qu’on essaie de faire c’est de ne pas le faire à la manière dont on va essentialiser les personnes.
[…]
Je l’ai expérimenté en autobio : quand tu écris ton autobiographie, tu parles de vraies personnes. Toi, déjà, un peu. Mais tu choisis ce que tu montres et ce que tu ne montres pas. Et puis tu choisis aussi par la technique ce que tu peux montrer et ce que tu ne peux pas montrer : je n’ai pas de souvenir complet de ce que j’ai ressenti à tel moment et dans la nuance. Donc tu fais des choix. Et finalement, prendre le parti de le faire volontairement en disant « OK qu’est-ce que je garde ? Qu’est-ce que j’essaie de dire ? Qu’est-ce que je fais comme caricature pour raconter mon histoire ? », le faire délibérément, ça te libère déjà de cette histoire de vérité qui est hyper compliquée à gérer dans ce type de texte. Et puis tu te rends compte que dans la fiction, c’est pareil : tu fais des choix.
Tu ne peux pas faire autrement qu’avec des clichés. Notre cerveau pense par catégorisation, si tu veux que le lecteur en te lisant comprenne de quoi tu parles, tu vas aller dans les catégorisations, peut-être que tu vas un peu les bousculer, mais tu ne vas pas livrer la totalité de ce que pourrait être une personne. T’es forcément sur une simplification, sur une fiche de personnage plus ou moins complexe (que tu vas écrire ou pas)
Soit on crée véritablement une nouvelle mythologie, c’est-à-dire une nouvelle norme, de nouvelles règles… et de nouvelles exclusions. Ce qui n’est pas franchement désirable.
Ketty : Moi en fait là-dessus (les nouveaux archétypes), ma première réaction, ça a été de me dire « mais pour quoi faire ? » Ça va peut-être se faire parce que les choses se sédimentent… mais moi je le vois pas du tout comme un objectif. On a quelque chose avec les grands récits qui me pose problème. En fait c’est plus possible les grands récits, parce qu’à un moment où à un autre, on laisse les gens de côté dans les grands récits.
C’est… ah ! Je vais redire le mot pluralité. Pluralité ! Pluralité…? Pluralité. Et une pluralité qui est capable de créer de la cohabitation. Quand je dis pluralité, c’est pas avoir le grand récit qui va écraser les autres, c’est d’avoir un récit suffisamment poreux pour que d’autres viennent s’y nicher, que ça bouge, que ça s’adapte. Donc tant pis si on n’a pas des trucs unifiés en fait. C’est pas grave.
Bien sûr il y aurait une part de notre ego qui serait flattée d’apprendre que nous avons contribué à créer quelque chose de nouveau : mais c’est un plaisir qui ne mène nulle part, car il réside dans la satisfaction d’avoir fait, et non de faire.
Comme je l’ai dit moi-même un peu plus haut : je crois qu’aucune règle ne vaille. Au mieux, elles sont des petites roulettes qu’on visse sur la roue arrière pour apprendre à faire du vélo, et dont on se débarrasse ensuite.
Alors en vérité, quand je me demande à quoi ressemblerait la littérature avec d’autres archétypes, ce n’est pas parce que j’ai l’ambition de les créer. J’aimerais au contraire que les choses bougent avant moi, que je puisse arriver en second, « écrire dans la lignée de » plutôt que de me casser les dents sur des expérimentations cheloues. J’aimerais avoir eu des petites roulettes adaptées à mon modèle de vélo pour apprendre, parce que j’en ai marre de me faire des bleus en tombant.
Sabrina : C’est ce que je dis à toutes mes étudiantes en classe : si vous êtes artistes, vous le savez. Parce que c’est la punition d’être artiste. C’est la liberté, mais c’est aussi la punition. C’est la solitude, c’est le doute permanent, c’est la peur de pas y arriver, c’est la peur de se dire que ça tient à rien ce qu’on fait, qu’on est très vite dépassée par tout, qu’il faut avoir du réseau, du charisme, du talent…
Ce n’est pas que je veuille à tout prix changer les structures narratives, c’est que celles qui existent, je n’arrive pas à les suivre (encore le dernier texte que j’ai écrit, je me suis dit « bon, c’est une nouvelle, c’est plutôt court : challenge > je vais écrire quelque chose avec de l’action ! »… j’ai écrit un texte métaphysique contemplatif sur la nature de la poésie… Bref)
Ketty : Mais en fait Eva dans ta question y’a encore ce truc du rapport à la norme qui m’amuse un peu parce qu’en vrai on fait ce qu’on fait, on est qui on est. Je ne commence pas en me disant « je ne veux pas écrire des structures ». La preuve : comme je disais, je l’ai fait sans faire exprès. Je me dis « j’ai envie de faire quoi ? » et je fais mon truc. Il se trouve que je suis câblée de façon suffisamment bizarre pour que ça tombe à côté de la norme à chaque fois, mais le jour où ça tombe dans la norme, bah c’est pas grave. Y’ a pas un effort pour être moi. Y’ a un effort pour mettre des baffes aux gens qui essaient de m’empêcher d’être moi. Mais être, c’est être.
Mais cette pensée (de ce que pourrait être la littérature dans un univers parallèle) ne m’aide pas. Le monde est tel qu’il est, et moi, je suis qui je suis.
Il faudra composer avec ce qui existe, accepter qu’il n’y a pas de nouveautés absolues, seulement des constructions faites d’un mélange de conformités et de subversions.
Saul : Oui et puis : on n’est pas en dehors de la norme, jamais. Moi pour le coup j’aime bien tout ce que peuvent raconter des gens (entre autres) comme Bell Hooks : la marge et le centre, ça se touche quand même.
Y’ a cette espèce d’idée qui me parait hyper bizarre, qu’on rencontre pas mal dans les milieux queers, mais surement dans d’autres milieux minorisés, qu’on est en dehors de la norme. C’est pas vrai. Ne serait-ce que si t’adoptes une posture intersectionnelle, t’as un pied dans la norme, une main ailleurs, un bras ailleurs. De la même manière qu’écrire pour briser une structure, écrire pour être en dehors de la norme me parait ultra glissant. Moi je préfère travailler aussi avec la norme.
Et dans le fond, c’est peut-être mieux.
Saul : En vérité je me méfie beaucoup de la nouveauté comme valeur esthétique supérieure. Je déteste aussi tout le truc scientiste de l’innovation qui va sauver le monde. « C’est bien parce que c’est nouveau ». Mais déjà, 1. Rien n’est nouveau. Et 2. C’est super d’investir des trucs anciens. Sinon moi je n’aurais pas écrit la séquence Aardtman : déjà ça parle d’un monde où les humains s’éteignent (cliché), ça passe d’un voyage de terraformation dans l’espace (cliché), y’a un ingénieur taciturne qui passe son temps à coder (cliché)… En fait si tu prends des figures comme ça et que tu les isoles, tu te rends compte qu’il y a des choses qui ont été faites mille fois.
Ce qui m’aide en revanche, c’est de constater qu’on n’est pas seul·es dans ce merdier, de lire et de mettre en avant des œuvres qui me parlent.
Voilà pourquoi : j’ai invité des autaires.
Parlons des livres de mes invité·es
Un échantillon enthousiasmant de la littérature d'aujourd'hui
Jouer avec les codes d’un genre
Sofia Samatar expliquait plus haut que la fantasy était son premier amour de jeunesse. C’était le mien aussi. Même aujourd’hui, je suis davantage versée vers la SF, mais j’ai toujours ce truc, chaque fois que je suis plongé dans un univers de fantasy : cette palpitation en forme de « oh lala ! Mais pouquoi je n’en lis pas plus !? »
Ce qu’il y a de particulier, avec la fantasy, c’est qu’elle est un genre très codifié : quand un univers commence à s’éloigner un peu trop d’un certain nombre de codes, on l’appellera autrement, et on le rapprochera plutôt de la SF (qui accepte plus volontiers de jouer les étiquettes « parapluies »)
Mais justement parce que le genre est très codifié, c’est l’espace par excellence pour jouer avec les codes. Ce que j’ai beaucoup aimé, à la fois dans Le Chant des Cavalières de Sam Marièm Corrèze et dans Un étranger en Olondre de Sofia Samatar, c’est qu’aucun des protagonistes de ces deux histoires n’est « un héros ».
Dans Le Chant des cavalières, on rencontre Sophie alors qu’elle n’a qu’une douzaine d’années. Il y a une ellipse au milieu du roman, mais elle est toujours très jeune, très peu sûre d’elle, toujours manipulée par les adultes autour d’elle.
De prime abord, le roman semble parler d’une prophétie, mais en réalité, on apprend dès le prologue que cette dernière a été inventée par trois complices pour servir leurs plans.
« Nous avons créé cette enfant de toutes pièces. Ses doutes, sa colère, son courage. Tout cela nous l’avons construit chez elle comme une tisserande assemble les fils sur son métier »
[Sam Mariem Corrèze, Le Chant des Cavalières, p.11]
Sophie n’a pas été choisie parce qu’elle est extraordinaire, elle l’a été parce qu’elle était jeune et manipulable.
Sam : On m’a reproché d’avoir un personnage principal trop passif. Sophie ne fait rien, laisse les choses lui arriver. Elle ne prend pas les choses en main, n’agit pas de son propre chef. Son paradigme c’est « OK, tu veux que je fasse ça ? Je vais le faire » ou « tu as choisi pour moi ce que je dois faire et penser ». Tout l’enjeu pour elle, c’est de lentement apprendre à prendre ses propres décisions. C’était très important pour moi. C’était vraiment l’histoire que je voulais écrire : l’histoire d’une personne en questionnement sur elle-même et sur sa place dans le monde. Pour moi, c’est l’histoire de l’émancipation de quelqu’un qui a grandi dans un environnement abusif, avec une famille pas vraiment « safe », et qui doit trouver la force de vraiment devenir la personne qu’iel veut être. Et c’est quelque chose de vraiment difficile quand on ne se sent pas en sécurité/accepté.
Au final, l’histoire parle beaucoup plus de comment on se sent chez soi que des évènements extérieurs qui arrivent en parallèle, comme le fait qu’une guerre soit en préparation.
Je pense que certaines personnes ont été frustrées de ça : que la guerre soit au second plan. Je ne montre aucune bataille, elles sont toutes « hors champ ».
Et au final, son parcours est anti-héroïque : elle n’apprend pas à devenir un héros, elle apprend à renoncer à en être un : à être une personne, et que l’épée mythique à sa ceinture ne soit plus… qu’une épée, comme il y en a d’autres.
Dans Un étranger en Olondre, le héros aussi est plutôt passif, mais pour d’autres raisons : Jevick est un adulte, mais c’est aussi un étranger.
Sophia : Quand je cherchais un éditeur, j’ai eu beaucoup de critiques me disant que mon héros était trop passif. Il ne fait rien. Il ne fait que se balader, regarder autour de lui et écouter les gens. Mais : C’est un étranger ! C’est dans le titre, n’est-ce pas : Un étranger en Olondre ? Il est un étranger dans le pays qu’il visite. Bien sûr qu’il ne fait que se promener et regarder et apprendre. C’est ce que font les étrangers. Du moins, c’est ce qu’ils devraient faire. Pas essayer de prendre possession des lieux ou de contrôler tous les enjeux politiques. Ce n’est pas son rôle.
Aussi, quand il commence à être hanté par « un ange » et que les prêtres d’Avalei font de lui un symbole (et donc une menace pour la religion dominante), il ne prend pas parti. Tout ce qu’il veut, c’est se débarrasser de son fantôme.
Un étranger en Olondre est une histoire d’apprentissage, mais ce n’est pas en surmontant des obstacles que Jevick apprend, c’est en continuant, quand bien même le pays qu’il visite se déchire autour de lui, d’observer Olondre, un pays qui l’a toujours fasciné et qu’il visite pour la première fois (en tant que commerçant qui prend la relève de son père décédé). Cela tient aussi du fait qu’en Olondre, il n’y a pas de magie forte, qui permettrait à Jevick de faire des choses spectaculaires rien qu’en suivant un apprentissage.
La magie, en Olondre : ce sont les mots.
« Ces sorciers […], par exemple […] n’écrivent pas seulement les nombres, mais également les mots, ce qui leur permet de converser par-delà le temps et l’espace, et une de leurs machines permet de fabriquer un nombre incalculable de copies du même livre. Comme celui-ci par exemple. »
[Sofia Samatar, Un étranger en Olondre, p.73]
Ce que Jevick apprend à faire, c’est à décrire le monde autour de lui, à prêter assez attention à ce que lui raconte son ange pour être capable de coucher son histoire sur le papier, comme elle le lui demande. En faisant ce travail, il se connecte au monde et aux autres.
Cet intérêt de Javick pour Olondre, ses mœurs, sa façon contemplative d’interagir avec son environnement se traduit notamment par une grande importance donnée aux descriptions. Importance qui était aussi une caractéristique du Chant des cavalières.
Sam : Peut-être que les paysages sont aussi une sorte de personnage. J’aime vraiment les montagnes et je travaille dans les forêts (enfin : j’étudie pour ça), alors je voulais qu’elles aient une grande importance dans l’histoire.
[…] Ce qui m’apporte le plus de joie dans l’écriture, ce sont les descriptions. Il peut y avoir plusieurs pages qui ne décrivent qu’une ou deux secondes de la vision d’un personnage. Ce dernier se promène quelque part (une ville, un bois, un bout de campagne…), cela ne dure vraiment pas longtemps, mais j’aime que cela prenne de la place dans le livre.
[…] La Terre qui penche est mon roman préféré de Carole Martinez : on y suit une jeune fille au moyen-âge, en France. Elle doit épouser le fils d’un Seigneur, mais ce dernier est très différent et les gens ne le comprennent pas (je crois qu’il est censé être autiste). L’héroïne n’a que dix ou douze ans, elle est très jeune. Des choses arrivent autour d’elle, mais principalement : c’est une enfant qui devient une adolescente. Juste ça, au moyen-âge, dans un monde très masculin et très brutal. Mais la langue est si belle, et la rivière est l’un des personnages de l’histoire : pas parce qu’elle parle, mais parce qu’elle a tant d’importance qu’elle donne l’impression de faire partie des personnages.Sofia: J’adore cette idée du paysage comme personnage !
[…] C’est étrange parce qu’en fantasy, tout est inventé, et c’est presque comme si, justement parce que tout est inventé, cela nous permettait de voir les choses différemment, d’interagir avec elle de manière neuve. Idéalement, j’aimerais que lire des livres qui présentent les paysages presque comme des personnages ait un impact, que cela influence la relation des lectaires et autaires avec les véritables paysages dans lesquels iels évoluent. Peut-être qu’iels peuvent avoir ce regard frais sur les paysages de fantasy et qu’ensuite cela les influence ou les aide à faire plus attention aux véritables paysages où iels habitent.
Finalement, ces deux romans (Un étranger en Olondre et Le Chant des cavalières) sont très ancrés dans le genre de la fantasy, mais en choisissant d’avoir des personnages qui observent plutôt qu’ils n’agissent, ils s’éloignent de la figure du héros.
C’est, je crois, ce que j’entends par « redonner de l’humanité aux personnages » : ne pas les réduire à leurs rôles agissants. Parfois, on ne fait rien, parfois on ne peut rien faire, parfois il est préférable de ne rien faire. Mais ce « rien » en termes d’action concrète n’implique pas qu’il n’y a « rien » à raconter. Il y a beaucoup à dire au contraire : personnellement, et il en va surement de même pour vous, il n’y a pas un jour dans ma vie où j’ai été en position de sauver le monde. L’essentiel de notre existence, nous la passons à être spectataire de beaucoup de choses sur lesquelles on n’a pas vraiment prise, et nos actions s’exercent dans un champ plus restreint : nos petits plaisirs, nos rêves et nos ambitions personnelles, nos relations avec autrui, etc.
Dans ces deux exemples, il est question de ce que l’on observe, de ce que l’on apprend par l’observation, des manières dont on s’émancipe… mais d’autres récits, de L’Espace d’un an à Subtil béton en passant par La Séquence Aardtman, choisissent de mettre l’accent sur les interactions entre les personnages.
J’avais déjà longuement parlé de La Séquence Aardtman de Saul Pandelakis dans mon précédent article, dédié au roman, mais pour le redire ici : il s’agit d’un roman de science-fiction qui commence par nous présenter deux personnages vivant chacun à deux bouts de l’espace. Sur Terre, Asha est une androïde trans qui réfléchit à la place qu’androïde et humain occupent les uns vis-à-vis des autres. Très loin dans l’espace, Roz est un humain (trans lui aussi) chargé de s’occuper de l’intelligence artificielle de son vaisseau. L’élément perturbateur, ou plutôt : ce que l’on croit être l’élément perturbateur, c’est qu’à un moment donné, l’IA du vaisseau cesse de fonctionner et est remplacé par une autre : Aardtman. Sauf que très vite, il apparait qu’Aardtman n’est pas du tout un « obstacle que les membres du vaisseau vont devoir surmonter » : c’est une personne. Son arrivée ne fait que créer de nouvelles interactions (c’est pour donner des conseils qu’Asha va être mise en contact avec l’équipage, et que des liens vont pouvoir se créer entre elle et Roz).
Aussi, il n’y a pas vraiment de « montée en tension », donc pas de climax.
Saul : Dans La Séquence Aardtman y’ a pas un moment de climax ultime. Et d’ailleurs ça m’interrogeait beaucoup quand je l’écrivais, je me disais « mais en fait les gens vont lire ce truc et ils vont se dire qu’il se passe rien. Ptet qu’ils vont s’ennuyer ? ». Mais moi j’aime bien l’idée d’avoir plein de petits climax. S’il y en a pleins, c’est comme si y’en avait pas, en tout cas y’en a pas un qui est identifié et qui serait « là où tout se passe ».
[…]
C’est super libérateur. Ça veut dire que plutôt que de se dire « il va se passer quelque chose d’incroyable ! », on est plutôt au quotidien avec les gens. Moi, c’est ça qui m’intéresse. J’aime bien être au quotidien avec les personnages, voir leurs expériences subjectives, savoir ce qu’ils pensent des trucs, leur train-train. […] Parce qu’en fait dans la vie, sauf trauma ou accident radical, c’est rare qu’on puisse localiser le jour où tout a changé. Souvent c’est pas un jour. C’est une semaine, c’est des mois. Et du coup ça me parait donner plus de libertés aux lecteurs et lectrices aussi, parce que c’est à eux et elles de déterminer quel était le moment important. Je ne leur dis pas. C’est à eux et elles de voir et d’accorder de la valeur aux moments qui selon elleux ont été marquants.
Jouer avec la forme
Par ailleurs, la forme peut être mise au service de l’histoire (et donc de sa structure).
Au tout début de notre entretien, Sofia Samatar a donné une définition du roman que j’aime beaucoup :
Sofia : Je pense parfois au roman comme à une technologie qui permettrait de changer le temps en espace : tu prends du temps, des évènements qui arrivent au fil du temps, et tu les transformes en quelque chose qui est un objet, un livre qui occupe l’espace en encapsulant ou en capturant le temps.
Ce qui me plait avec cette idée de « technologie qui transforme le temps en espace », c’est qu’il y a cette notion de transformation : il ne s’agit pas seulement de traduire le temps en espace, de le retranscrire d’une manière qui serait forcément linéaire. Il s’agit de prendre une matière première (plusieurs évènements que l’on pourrait placée sur une frise temporelle), et puis en faire tout à fait autre chose.
On peut raconter les choses dans le désordre :
Saul : Dès que tu sors de la linéarité dont parlait Ketty, t’arrives à des formules qui sont plus complexes et dans lesquelles tu vas pouvoir faire résonner des chapitres à distance. On sort de ce truc où « ah il faut un truc énorme ! Il faut qu’un truc explose ! » Moi je trouve ça libérateur.
On peut raconter les choses selon plusieurs points de vue : quelque part, le fait même d’avoir deux personnages plutôt qu’un seul contribue à diluer la figure du héros (même s’il y en a, il n’est pas unique, et exactement comme disait Saul Pandelakis un peu plus haut à propos des climax « S’il y en a pleins, c’est comme si y’en avait pas, en tout cas y’en a pas un qui est identifié et qui serait [LE héros] »)
Saul : Il se trouve aussi que ça remplit plusieurs fonctions : la polyphonie elle est pas là pour être polyphonique. Elle arrive. À partir du moment où j’ai envie de délester mon récit principal de tout un tas d’exposés sur « comment on en est arrivé là ? », il devient nécessaire de créer les interludes pour expliquer comment on en est arrivé là. Comme j’ai pas du tout envie de raconter ça d’un point de vue omniscient de « alors en 2100 il s’est passé ça, et en 2105 il s’est passé ci », je passe par des histoires personnelles. Donc en fait la polyphonie est aussi au service du worldbuilding.
Quand on disait tout à l’heure « un personnage n’est pas qu’une chose », c’est pareil pour des éléments d’écritures : ils ne sont pas là pour une seule raison.
On peut aussi utiliser des formes qui ne sont pas celles du type de texte que l’on est en train d’écrire (car les structures « classiques » ne sont pas les mêmes pour les romans, que pour les nouvelles, que pour les articles scientifiques, que pour les carnets de voyage, etc., etc.)
Saul : J’écris de base plutôt de la recherche, là on a une méthodologie pour la structure d’un article : on a des références plus claires sur comment on s’y prend. Du coup ça m’intéresse aussi de voir comment j’engage l’écriture différemment quand je suis pas dans de la recherche et que je suis vraiment dans de l’écriture de fiction.
À ce niveau, le dernier roman de Ketty Steward, L’Évangile selon Myriam, qui se situe entre le roman et le recueil de nouvelles, est très intéressant.
Personnellement, la nouvelle est un exercice que j’ai découvert sur le tard. J’ai commencé à en écrire un peu par hasard, et c’est avec la pratique que j’ai pris gout au format.
Je trouve qu’il y a dans la nouvelle une liberté bien plus grande que dans le roman : parce que le texte est court, il permet d’expérimenter plus. Cela ne veut pas dire que toutes les nouvelles sont originales, mais si on veut tenter des choses, c’est le format idéal.
En termes de structure, d’abord, c’est un peu différent : souvent, il ne va pas y avoir toute la partie exposition, on va arriver directement au milieu d’une scène (les nouvelles ne se limitent pas à ça, mais classiquement, sa définition implique une unité de lieu, de temps et de personnages. Donc : une scène). Or, arriver au milieu d’une scène sans connaitre les enjeux, c’est accepter de se laisser porter. Il n’y a pas forcément une ligne directrice, ce truc dont parlait Le Guin, une forme du récit qui serait « celle de la flèche ou de la lance, partant d’ici et filant tout droit jusque-là, et TCHAK ! touchant son but ».
D’une manière générale, la structure d’une nouvelle n’est pas la structure globale qu’on trouve dans un roman (début, milieu, fin), c’est la structure de la scène, si bien que la distinction que je faisais au début (structure narrative VS forme) est moins marquée. Jouer sur la forme, en nouvelle, c’est déjà jouer sur la structure.
Sofia : J’aimerais parler de Carmen Maria Machado, qui est à la fois une autrice fantastique et une amie. Carmen a publié deux livres : un recueil de nouvelles intitulé Son corps et autres célébrations, et une autobiographie qui s’appelle Dans la maison rêvée et qui joue avec toutes les structures folkloriques. C’est merveilleux.
Si l’on me demandait maintenant, à ce moment précis, qui en fantasy et science-fiction fait un travail absolument époustouflant en termes de structures narratives, je répondrais Carmen tout de suite, parce qu’elle joue avec les formes. Elle a écrit une histoire sous la forme d’un quick-starter, une autre sous la forme d’un épisode de La Loi et l’ordre, une autre encore sous la forme d’un inventaire… Les manières dont elle joue avec les formes et les structures sont vraiment intéressantes. Elle est impressionnante.
Or comme je l’ai dit plus haut, L’Évangile selon Myriam est constitué essentiellement de textes écrits par le personnage de Myriam, tous ces textes (réécriture de mythes et conte) sont très courts, et pourraient être lus indépendamment.
Mais ce n’est pas que des nouvelles mises ensemble dans un même livre : chaque mythe ou conte repris est découpé en deux ou trois morceaux, entre lesquels s’introduisent les fragments d’une autre histoire.
Les morceaux sont reliés entre eux, non pas par un arc global qui ferait progresser une « super-histoire » dont les nouvelles seraient des morceaux, mais par un lien thématique.
Ketty : Le retour que j’ai eu sur L’Évangile selon Myriam, c’est ça se voit que c’est des petites histoires mises bout à bout. « On a son petit feuilleton avec une histoire qui va être juste coupée en deux donc on attend de voir ce qui va se passer pour l’autre partie. Mais ça se tient tout seul. ». Je ne me suis pas dit « il faut absolument que ça tienne tout seul », mais je bosse comme ça. J’ai envie de raconter l’histoire de Jonas qui ne veut pas aller à Ninive, je raconte l’histoire de Jonas qui ne veut pas aller à Ninive. S’il se passe un truc concernant Jonas ça va être là-dedans, et on peut refermer en disant « J’ai lu l’histoire de Jonas ». Quitte à ce que après je fasse des liens avec quelqu’un d’autre [qui serait un autre prophète qui n’a pas envie de prêcher] et là tu refais du lien.
J’aime assez l’idée de petites îles comme ça, des îles d’histoires qui après vont faire un truc plus grand, mais qui se suffisent à elles-mêmes. C’est encore mon gout pour la forme courte : c’est des petites unités de sens.
Au final, il est difficile de dire quelle est l’histoire de L’Évangile selon Myriam. Personnellement, je me suis beaucoup amusé à comparer les réécritures de Ketty/Myriam avec mes propres réinterprétations. Ce qui est sûr, c’est que le tout laisse une large place à l’interprétation : c’est à nous de décider comment on reçoit le recueil de textes, d’inventer l’histoire de Myriam à partir de ses écrits et des quelques éléments de contexte qui nous sont donnés.
Ce que fait L’Évangile selon Myriam, c’est rapporter un peu de ce que sont les nouvelles à l’intérieur d’un roman.
Bref, j’aime beaucoup la démarche.
Jouer avec… hum… soi-même ?
De manière générale, je dirais que l’objectivité n’existe pas : quand il est question de chronique littéraire, on parle au moins autant de soi (au travers de ce que le livre a produit chez nous) que du livre en lui-même. Mais je crois que cela est particulièrement vrai pour les romans de Sabrina Calvo.
Ce sont des textes personnels, ils parlent de quelque chose qui pourrait ressembler à un fait divers, et puis petit à petit, page après page, ils virent vers quelque chose d’autre, quelque chose d’intime.
Sabrina : Souvent j’arrive dans mes points limites, c’est-à-dire des endroits où j’ai mis tellement de choses contradictoires que je sais même plus si ça a du sens. Tout mon travail c’est de remonter à la source de ces choses contradictoires pour essayer de voir où j’ai engagé du sens dans mon récit que j’avais pas vu. Donc des mots, des principes des choses […] Ça va pas plus loin que ça. C’est du travail poétique sur les sonorités, sur les images, sur ce que je vis. Je fais ma mélasse avec ça, avec une direction globale qui est vers la destruction, vers le larsen, vers la révélation quoi.
Et c’est tout. Vraiment je t’assure, y’ a rien d’autre.
Les choses prennent sens au fur et à mesure du livre, mais c’est un sens un peu particulier : parce qu’il est absurde, parce qu’il est créé en temps réel, et parce qu’au final, il ne fait sens pour nous lectaires que si on veut bien lui en trouver un, faire entrer le livre en résonance avec notre propre intériorité, nos propres paradoxes, notre propre absurdité inhérente.
J’avais déjà parlé par le passé des trois précédents romans de Sabrina Calvo (ici) en relation avec une quête de soi, en fait : une quête de sens que l’on retrouve dans Melmoth furieux.
Mais le sens que l’on trouve (ce que les personnages découvrent, mais aussi ce que l’autrice invente au fil de l’écriture, et ce que nous-mêmes recevons de la lecture) est en constante évolution. Pas parce que les intensions sont différentes, mais parce qu’en tant qu’êtres humains nous sommes en constante évolution, et l’on ne va pas projeter les mêmes choses d’un jour au lendemain.
J’ai lu Melmoth furieux dans un contexte différent de Toxoplasma ou Sous la Colline : trois ans plus tard, alors que j’étais déjà en train de réfléchir à ce présent article (avec déjà l’intention d’y inviter Sabrina).
Ce qui m’a marqué avec ce livre, c’est à quel point il me parlait du processus de création lui-même : le truc c’est que, comme Sabrina Calvo l’explique elle-même, ses romans ont globalement toujours la même forme.
Sabrina : je commence toujours de la même manière avec quelqu’un qui se réveille, et je termine toujours de la même manière avec des gens qui disparaissent dans des larsens.
Dans Toxoplasma, le récit commence avec un fait divers : Nikki veut partir enquêter sur le meurtre d’un raton laveur. Dans Melmoth furieux, le point de départ pourrait aussi ressembler à un fait divers : Fi veut s’en aller brûler Eurodisney. Sauf que ce n’est pas une information que je reçois pareil : si un raton laveur est mort quelque part, même si c’est de façon glauque et tordue, je peux prendre ça comme une anecdote qui sert d’accroche. Si c’est l’héroïne qui veut aller brûler Eurodisney, j’aime bien savoir pourquoi.
Or, au début de Melmoth Furieux, on ne sait pas pourquoi (et certes, en un sens, ce n’est pas vraiment le sujet, but still : moi je veux savoir).
Sabrina : Dans Melmoth le leitmotiv c’est des gamins qui veulent aller brûler Disneyland, et en fait on se rend compte au bout de cent pages que c’est pas le sujet du livre. Le sujet du livre c’est la couture et l’amour. Et oui bien sûr qu’il y a ce truc au fond, cette quête mythique qui doit arriver et qui arrive. Mais en fait c’est un détail. Et même la fin : la résolution n’est finalement pas tant sur le fait de brûler Disneyland que de ne pas laisser les autres brûler notre maison à nous.
Et quand je dis « on ne sait pas », en l’occurrence : l’autrice ne sait pas non plus. Y’ a des premières pistes d’explication qui parlent de camp de concentration dans les locaux d’Eurodisney, ça faisait un peu conspi. J’attendais davantage, et puisqu’il y avait cette attente de ma part, je voyais en direct ce processus de « retrouver où j’ai engagé du sens » se dérouler.
Sabrina : Par exemple : une scène dans Melmoth, quand elle arrive dans le commissariat et qu’elle trouve la montagne de fringue, là, avec le pauvre Villon dedans, recroquevillé tout nu… Je savais même pas ce que j’écrivais.
J’étais bloquée, je savais pas du tout ce qui allait se passer, et je me suis retrouvée à errer dans une forêt. Je me souviens que c’était en pissant à croupie contre un arbre qu’à un moment donné j’ai vu l’image de ces fringues entassées jusqu’au plafond. Je me suis dit « Wow c’est complètement dingo cette histoire ! C’est quoi ? Qu’est-ce qu’il y a derrière quoi ? » Du coup je l’ai écrit et puis j’ai cherché ce qu’il y avait derrière, et c’était la clef de la fin du livre : le merchandising des amis imaginaires transformés en T-shirt que j’avais pas avant ! Littéralement pas quoi ! […]Je vais chercher le truc le plus what the fuck possible et après je retro-engineer mon récit pour voir comment ce truc what the fuck auquel je tiens peut rentrer dans l’histoire.
Cette histoire d’amis imaginaires transformés en T-shirt informes estampillés Disney, vous la faite résonner comme vous voulez : cela peut vous évoquer les enfants star de Disney, tenu par l’enseigne de projeter une image parfaite, et qui pour la plupart se sont vus passer par une phase d’hypersexualisation et de dramas à répétition pour s’émanciper de l’image « mousekeeters » qui leur collait à la peau. Cela peut vous questionner sur les mastodontes du divertissement et/ou des médias : ces quelques compagnies en position de quasi-monopole (en ce moment dans le milieu littéraire français, le rachat de Bragelone par Hachette Livre fait beaucoup de bruit, par exemple). Cela peut vous parler de surconsommation et de capitalisme. Comme vous voulez.
Et au final, pour moi : cela parle de structures. Pas uniquement les structures narratives, mais toutes les structures, celles qui nous influencent à tous les niveaux, les normes invisibles, les pseudo « règles » qui ne disent pas leurs noms.
La structure des villes notamment
— Je capte pas, tu veux dire qu’inconsciemment tout le monde répète la structure d’organisation du parc, même… nous ?
— C’est ça.
— C’est complètement con.
— Pas forcément […] On sait depuis un certain temps déjà que la Métrique opère suivant un plan précis, à travers toutes les couches de la société — c’est un dogme implicite qui a bouffé nos valeurs, nos amours, nos amies.
[Sabrina Calvo, Melmoth furieux, p.202]
Et puis la structure des vêtements : T-shirt coton-polyester en forme de T, cousu à la chaine avec une impression sur le devant, tandis que Fi rêverait de changer le monde avec une robe, un vêtement qui exprimerait vraiment quelque chose.
— Je dis bien que c’est notre chance. À nous la marge, à nous les voix qui parlent jamais et dont tout le monde se fout bien. Je dis qu’on peut gagner cette guerre avec une robe.
[Sabrina Calvo, Melmoth furieux, p.230]
C’était l’objet des parties précédentes : il n’y a pas de manuel pour sortir de toutes ces structures (narratives ou non) que l’on a intériorisées.
Sabrina : C’est un travail sur la peur, c’est un travail sur l’attachement, c’est un travail sur les certitudes, c’est un travail sur le lâcher-prise, c’est un travail sur l’imagination. C’est un travail quotidien, c’est comme un muscle quoi. Ça se pratique. Après quand t’en fais ta vie, t’en fais ta vie quoi.
Mais cela fait tellement de bien d’avoir un roman qui (et même si c’est juste mon interprétation) me parle de l’importance de s’émanciper de ces structures, de poursuivre ses propres rêves (même si c’est pas forcément « réalisteTM » de sauver le monde avec une robe), et défendre ce et celleux en qui nous croyons.
Oh mon souffle
— drapeau noir léché de rose.
[Sabrina Calvo, Melmoth furieux, toute dernière ligne]
Conclusion
Existons ensemble
En sommes, nous existons, nous et nos histoires.
Ketty : Eva, tu disais « y’ a des gens qui font différemment », et en fait c’est pas ça le problème dans le milieu de la science-fiction. C’est pas qu’il y ait ou qu’il y ait pas. Il y a toujours eu des gens qui faisaient différemment.
Mais la science-fiction fait comme mes patients dépressifs : elle se raconte toujours la même histoire, en prenant toujours les mêmes éléments, avec une orientation bien particulière et se renouvelle pas dans son récit d’elle-même.
Et c’est ça mon boulot sur [l’essai que je suis en train d’écrire] : c’est montrer comment tu peux récupérer des choses laissées de côté dans l’histoire de la SF, ou des choses qui se font actuellement, pour pouvoir se raconter autrement ce que c’est notre genre, pas rester sur un truc qui se regarde le nombril avec toujours les mêmes références.
La question, à présent, c’est comment mettre tout cela, la richesse de la littérature, en avant. Parce qu’en attendant, mes invités me racontent un peu la même histoire : c’est dur de trouver une porte de maison d’édition qui veuille bien s’ouvrir, et quand on en a ouvert une, on se rend compte qu’il y en a une infinité d’autres derrières.
Sofia : Ça a été un long chemin pour publier un étranger en Olondre. C’était très difficile et il m’a fallu plus de cinq ans pour y parvenir.
Ketty : Ça fait dix-neuf ans que je suis là et que je ne bouge pas. Je suis pas restée parce qu’il y avait une reconnaissance folle. Non. C’est plutôt des injures et du mépris. La solution de facilité ce serait de se dire « bon bah je vais ailleurs » ou « je vais faire mon propre truc, ma propre maison d’édition ». Mais non. Moi je veux être là. Je veux faire mes trucs. Quitte à maintenant publier mes textes qui ont dix ans et que les gens disent « oh, mais c’est super, c’est nouveau ! T’as vachement progressé ! » non, bah ça c’est écrit y’a dix ans et je n’y ai rien changé. On fait comment ?
[…]
Est-ce que c’est pas un peu long vingt ans ? Est-ce que c’est pas un peu cher payé vingt ans de rien et de remises en question personnelles, en disant « c’est moi qui sait pas faire/c’est moi qui joue pas le jeu/j’ai pas compris les règles » […] Je suis là, je vois des gens arriver en deux ans ils font tout : ils proposent leurs trucs, on leur redemande, ils sont partout, ils ont tous les prix, ils ont tous les trucs. Et tu luttes pour ne pas te dire « mais qu’est-ce que j’ai de moins ? »
Moi ce qui m’a sauvée, c’est finalement d’avoir plein de problèmes. Parce que pendant que t’es en train d’essayer d’être un être vivant, juste vivant, et bien t’es pas en train d’espérer une reconnaissance ou quoi que ce soit d’un milieu qu’en a rien à foutre. Donc effectivement, ça passe. Quand t’es pas en train d’espérer quelque chose, t’as pas de désespoirs et de déceptions. Mais c’est pas terrible quoi.
[À une jeune autrice qui va pas bien], je peux pas lui dire « non, mais écoute, si t’es suffisamment désespérée dans la vie, ça va se passer, et dans vingt ans il se passera quelque chose pour toi. Tiens bon, gère tes problèmes, change de métier deux fois, fais une thèse… ça va tellement t’occuper que t’y penseras pas, et puis un jour, peut-être, par miracle, ça va bien se passer ».
Les règles du jeu sont tellement pipées que je peux rien dire. Je peux pas donner de conseils non plus parce que je ne sais pas. C’est à force d’être là, je suis devenue à la mode, mais il est hors de question qu’on me dise « c’est parce que t’as bossé, tu ne savais pas faire et maintenant tu sais » puisqu’ils me ressortent des vieux trucs, là.Sabrina : Tu vois bien ce que j’écris ! J’écris pas des livres qui sont destinés à être des bestsellers, j’écris pas des livres qui sont destinés à être lus par le grand public, j’écris pas des livres qui sont destinés à être envisagés comme étant dans un continuum de mainstream. J’écris les livres que j’ai envie d’écrire. C’est tout quoi.
J’ai aucune autre prétention que de faire ce que je sais faire.
S’il se trouve qu’après vingt ans, vingt-cinq ans d’écriture, trente ans d’écriture, j’ai misérablement un petit succès d’estime que mon travail et mon œuvre ont aujourd’hui et me permets de vivre d’autres choses avec mon écriture, ben… so be it, quoi tu vois.
Alors c’est long, il faut s’accrocher, il faut du temps (et de la chance) pour trouver un éditaire qui nous fasse confiance pour un premier roman, et une fois que c’est fait, on continue à galérer, ou bien on se fait rattraper par la précarité et c’est plus possible. Y’ en a qui font autre chose (du dessin, des vidéos, qui se reconvertissent dans des médias où le retour du public est plus immédiat, où y’ a moyen d’ouvrir un U-tip). Y’en a qui ne font plus rien, trop occupé·es à survivre.
Et dans tout ça, histoire alternative : y’ en a qui n’essaient même pas. À quoi bon ?
Saul : Il se trouve que j’ai une variante de cette histoire-là qui est que moi j’écrivais même pas en fait. J’étais persuadé que c’était pas pour les gens comme moi. Il a fallu des séries de petits accidents où j’ai essayé sans pression, à causes de contextes très différents. Déjà je me suis dit « ah en fait j’y arrive », mais j’étais surpris. J’avais intériorisé l’idée que je ne pouvais pas, pour des raisons de genre, classe et tout ce qu’on veut. […]
Du coup t’as la variante où t’écris et ça passe pas parce qu’effectivement on ne te voit pas comme un sujet qui écris. Et puis t’as la variante où c’est « toi-même » qui te coupes les jambes en te disant « de toute façon les grands auteurs, c’est pas moi, la preuve : à la télé je les vois, ils me ressemblent pas… ». C’est intériorisé. Moi c’est vrai que ça me fait de la peine.
Ketty : Mais c’est pas toi-même qui te coupes les jambes. C’est l’état du marché du livre.
Alors quand je parle des livres que j’aime, la question subsidiaire est toujours : comment les faire exister ?
J’aime bien l’idée d’un commun : pas forcément une équipe précise qui bosse ensemble, mais des efforts collectifs pour nous mettre en avant mutuellement. Pour donner aux un·es le courage de se lancer, aux autres la force de poursuivre. Même combat.
Ketty : Je pense qu’il faut créer ses propres lieux. Je pense à des lieux interstitiels. Par exemple Writever [NdlR: Initiative de Ketty Steward consistant à écrire une microfiction par jour sur twitter, tous les jours, sans date de fin].
Writever c’est une initiative qui permet d’utiliser un canal qui n’est pas tout à fait pour, pour faire écrire des personnes. Ce qui va en ressortir j’en sais rien. Mais j’ai vu des gens commencer à écrire timidement et très maladroitement, et prendre de l’assurance. J’ai vu des se remettre à écrire d’autres trucs après en avoir fait un petit peu. Je reçois des messages aussi.
Un moment je me dis « mais ça sert à quoi ? C’est n’importe quoi… » et puis tu reçois un message d’une personne qui te dit « mais c’est génial ! En ce moment j’écris pas, mais je lis tout ce qui sort et c’est vraiment bien. Ça me donne envie. Le mois prochain je viens ! » et pof la personne vient.
Ça mobilise du collectif à sa façon. On n’est pas dans le circuit économique de l’écriture. Mais c’est de l’écriture, c’est de la création collective, c’est du partage. Et c’est pas un lieu qui était fait pour : je suis pas allé dire à une maison d’édition « est-ce qu’on peut faire des micronouvelles chez vous ? ». [Cela dit] je pense qu’on va les retrouver dans des maisons d’édition d’une manière ou d’une autre.Sam : Et aussi : faire autant d’ateliers d’écriture que possible avec des élèves. Les collégiens qui viennent à mes ateliers d’écriture sont toujours queers. Dès que je commence à travailler quelque part, j’attire tous les enfants un peu LGBT. C’est comme s’iels pouvaient sentir que j’étais là pour eux, et iels finissent toujours dans le club d’écriture.
J’aimerais qu’on travaille à un futur où on puisse être plusieurs (c’est le mot préféré de Ketty : Pluralité).
Saul : Insister aussi pour qu’il y ait du dialogique. Je pensais vachement à ce mot quand tu parlais tout à l’heure de pluralité. Là je travaille pas mal avec Muriel Plana qui défend énormément ça dans l’écriture théâtrale : c’est d’arriver à avoir plusieurs voix et dire « non, mais ça suffit. Faites des tables rondes. Et pas des tables rondes sur la diversité, y’ a plein d’autres sujets. Invitez DES gens. C’est quoi ce réflexe toujours d’inviter “le’ grand auteur ? (parfois quand on a de la chance : la grande autrice, mais la pluralité s’arrête à peu près là) »
C’est un truc que je vois aussi à d’autres endroits avec des gens qui sont convoqués pour faire des expertises et qui me disent « mais c’est horrible : quand on t’appelle pour être un expert dans les médias, si on t’aime bien on va te rappeler tout le temps. Tu vas devenir l’expert de Machin-Chouette et on va entendre que toi. » Et en fait, la plupart des gens qui sont modestes vont dire « non, mais moi ça je connais pas le sujet » ou « moi je ne m’exprime pas là-dessus » ou « ah bah non je vais pas y aller sinon c’est toujours les mêmes qui s’expriment »… ces gens-là qui seraient les plus intéressants se mettent eux-mêmes hors-jeu, et les gens qui prennent les places sont les gens qui ont zéro honte à être LA personne qui parle, qui est l’expert.
Et puis insister : faire savoir que l’on existe, rester là. Écrire.
Ketty : Y’ a une autre façon, qui est d’être là. Moi c’est ce que j’ai fait depuis dix-neuf ans. Je suis là et que je ne bouge pas.
Sam : Je crois qu’une des premières choses à faire pour encourager les autres à écrire, c’est d’écrire soi-même. Parce que d’autres vont nous lire. Peut-être qu’iels trouveront ça vraiment mauvais, et ça leur donnera envie d’écrire quelque chose de mieux. Ou peut-être qu’iels trouveront ça super, et iels penseront « Si ce livre marche, s’il est sur les étagères d’une librairie, cela veut dire qu’un éditeur a cru en cette histoire, et puis un diffuseur, un libraire… Et si cette histoire dans laquelle moi, une lesbienne avec un quart de sa famille qui est d’Asie, j’ai pu me reconnaitre, alors peut-être que je peux écrire quelque chose du même genre ».
Sofia : Oui ! C’est aussi ce à quoi j’ai pensé en premier : on encourage les autres en écrivant soi-même, et surtout en publiant nos travaux. Je veux dire : moi, j’écrirai de toute façon. C’est comme si j’avais un genre de virus (cette métaphore sonne étrangement ces temps-ci…). Mais publier est vraiment une tâche lourde. Elle implique toute une série de relectures et de révisions que je n’aime pas faire, qui sont fatigantes. Mais je crois que cette partie-là du travail aussi est très importante.
Peut-être que j’insiste trop sur cet aspect, que Ketty Steward a raison quand elle me dit que toutes les raisons d’écrire ne sont pas bonnes (la gloire, la fortune, l’idée qu’on va obtenir par ce biais un genre de réparation…).
Mais au pire quoi ? Si, parce que je dis trop fort qu’il faut encourager l’écriture, Bidule-qui-n’a-rien-à-dire-mais-se-dit-que-ce-serait-stylé-son-nom-sur-une-couverture écrit un roman tout nul qui n’est qu’une redite sans âme de clichés depuis longtemps éculés… so what ? Ce ne sera ni le premier ni le dernier, et ça pourrait même plaire à quelqu’un, sur un malentendu.
Ce n’est pas à Bidule que je m’adresse.
Je m’adresse à toutes les personnes qui écrivent (ou qui « aimeraient écrire s’iels avaient le niveau » > spoiler : ça n’a jamais été une question de niveau. Comme dirait l’autre : le talent, c’est d’avoir envie) et qui ont besoin de savoir qu’elles ne sont pas seules, qu’il y aura des gens pour soutenir le travail, que ce soit à leurs débuts…
Une recommandation de Sam : Fran Basil a publié une nouvelle [Alba de jais, l’anonimographe] dans la même anthologie que moi. C’est l’histoire d’un conflit politique entre des lapins et des corbeaux. Je sais qu’elle écrit des histoires incroyables. La narrativité est un jeu pour elle : pas parce que c’est facile, mais parce qu’elle peut la faire plier selon sa volonté. Parfois, elle parle de ses projets, et tu te dis « OK? Mais comment tu vas faire marcher ça ? » et ça marche ! Elle est douée à ce point.
Et donc : j’espère vraiment que sa trilogie sera publiée, parce que je veux la lire dans un véritable livre papier. Et aussi parce qu’elle a beaucoup de talent et j’aimerais qu’il soit reconnu.
… ou après trente ans de carrière :
Une recommandation de Sofia : Greer Gilman est l’autrice d’un bon nombre de merveilleux romans. […] Je l’ai interviewée [pour Uncany magazine, lien] le mois dernier, en décembre, parce que c’était le trentième anniversaire de son roman Moonwise. Moonwise donc, a paru il y a trente ans, c’est très dense, et tellement riche ! C’est l’histoire de deux jeunes femmes qui sont des amies d’enfance. Enfants, elles avaient un jeu, elles avaient inventé un pays imaginaire appelé « Cloud ». Et voilà qu’en grandissant, ce pays s’avère non seulement être un endroit réel dans lequel elles peuvent se rendre, mais aussi être bien plus dangereux et effrayant qu’elles le pensaient. Les deux livres [Moonwise et sa suite Cloud and Ashes] sont juste splendides. Je les adore.
Voilà pourquoi je ne fais pas qu’écrire. Ce n’est pas tant pour me faire remarquer (mes articles sont probablement trop longs pour ça, de toute façon). C’est que j’ai constaté que chaque fois qu’il m’arrivait quelque chose de bien, c’est qu’il s’était trouvé une personne pour me tendre la main.
Ce que je veux, c’est m’assurer de la tendre en retour, par ce blog, ou par le biais de fantastiqueer, ou par d’autres moyens dont je n’ai pas encore idée.
Sofia : Une autre chose que l’on peut faire est de mettre en avant d’autres voix chaque fois qu’on en a l’occasion. Si quelqu’un nous demande des recommandations de lecture, si l’on est en interview ou que l’on participe à une discussion publique en tant qu’écrivain, alors on peut mentionner d’autres livres écrits par des auteurs issus de diverses communautés marginalisées. Je pense que cela aide à faire circuler ces voix dans l’imaginaire collectif. Avec un peu de chance, cela fera découvrir ces écrivains à de nouveaux lecteurs.
Parce qu’en vérité : chaque voix est unique.
Que ce soit :
- en termes de réflexion (politique, philosophique, etc.)
Sam : Le livre que je suis en train d’écrire parle de démocratie et de son avènement. Mes personnages traversent une révolution et une rébellion contre un pays colonisateur. Iels ont des débats philosophiques sur « quelles structures faut-il mettre en place pour obtenir une démocratie fonctionnelle ? Serait-ce une république ? Garde-t-on un prince dont la fonction serait purement décorative ? Va-t-on faire des élections ? Faut-il élire des gens pour prendre les décisions ? »
Ce livre contient toutes mes réflexions sur la démocratie et la république, sur comment créer le moins pire des systèmes pour des êtres humains, le tout dans une histoire de personnages queers qui trouvent l’amour et font la révolution.
- en termes de voix (par exemple : une de mes dernières lectures est Subtil béton, du collectif les aggloméré·es. Et j’ai été marquée d’à quel point l’écriture collective produit quelque chose de différent de l’écriture solo. Quand je (ou qq1 dans son coin) écris un texte, je vais avoir tendance à donner raison à mes personnages. Même quand j’essaie de montrer la complexité du réel, et le fait que des fois Truc et Bidule pensent des choses opposées sans que cela signifie que l’un. e ait raison et l’autre tort, il va rester certains points où, en fait, j’ai un avis et où, du coup, il va transparaitre. Mais sur un livre écrit à plusieurs, il n’y a pas un avis qui apparait comme « voilà ce que pense l’autaire » et pour cause : il n’y a pas d’autaire. Il y en a plusieurs, qui ne sont pas d’accord et qui, du coup, dialoguent entre eux entre les lignes. Quand je lis Subtil béton, ce ne sont pas des passages/répliques que j’ai envie de garder, ce sont des passages entiers : des enchainements de plusieurs avis contradictoires. Il y a quelque chose de vrai dans la manière dont les idées s’enchainent, se répondent, se contredisent sans s’écraser, et c’est une chose que j’avais déjà ressentie en lisant d’autres textes écrits à plusieurs lors d’atelier, comme Bâtir aussi, du collectif de l’Antémonde, ou Ça ira, fin de Louis (1) de Joël Pommera)
- en termes d’histoire personnelle, d’identité ou d’histoire familiale
Sofia : Mon dernier livre, qui sort en octobre, est un essai intitulé « The white mosque ». C’est un peu l’histoire d’une obsession. Je me suis fascinée pour l’histoire de germanophones mennonites qui ont voyagé depuis la Russie jusqu’à l’Asie centrale dans les années 1880. Ils ont créé un village qui a existé pendant cinquante ans dans l’actuel Uzbekistan. C’est un moment de l’histoire où les mennonites sont partis habiter dans un pays musulman, et c’est pour cela que je m’y intéresse tant : ma famille est mennonite d’un côté et musulmane de l’autre. Alors je suis vraiment intéressée par cette idée d’une connexion à travers la race, la religion, l’ethnicité et toutes ces choses.
Le livre raconte cette histoire, mais aussi mon intérêt pour cette histoire, mon voyage en Uzbekistan et les réflexions qui sont ressorties de cette expérience.
- en termes de compétence ou savoir technique (par exemple : Dans la série de romans de Yoon Ha Lee dont le premier tome s’appelle Le Gambit du renard, on nous présente un monde dans lequel tout est régi par des mathématiques totalitaires. C’est une série très particulière dont, personnellement, je suis fan, qui est à la fois un space opera militaire et, entre les lignes, un texte qui dépeint un univers fort réjouissant en termes de genre. Et par-dessus tout, pour moi qui ai fait mathsup : on sent que Yoon Ha Lee est mathématicien. Les mathématiques présentées n’existent pourtant pas, mais la façon dont elles sont décrites : c’est presque de la hard-science) (Notez que je ne mentionne pas cette série au hasard : l’éditeur français a décidé d’abandonner la publication avant la sortie du troisième tome alors que les deux premiers ont paru en grand format ET en réédition poche. Alors si ça peut faire pencher la balance : aller lire Le Gambit du renard. C’est une lecture exigeante, mais de très très haut niveau. Je veux la suite !)
- en termes d’intimité et de quotidien et de sensibilité propre
Sabrina : J’parle de moi quoi, c’est ma vie. Fi [personnage principal de Melmoth furieux] c’est moi. Nikki [personnage principal de Toxoplasma] c’est moi. Colline [personnage principal de Sous la Colline] c’est moi. Je ne fais que parler de moi. Des fois il va m’arriver des choses dans le quotidien qui vont se retrouver dans le livre, et des fois tout m’échappe.
- en termes de références, d’influences conscientes ou non qui s’agglomèrent dans nos propres récits
Ketty : J’aime bien l’idée des inspirations et je crois que c’est ça les plus fortes : celles que tu n’identifies pas au moment où tu bosses.
- En termes de vécu (dans la liste rapide des livres qui m’ont frappée en plein cœur par leur exactitude : Eau douce de Akwaeke Emezi ou Stone Butch Blues de Leslie Feinberg)
- En termes de tout ça à la fois
La littérature est riche parce que nous (mes invité·es, les autaires de talents cités au cours de cet article, les autres autaires qui écrivent à travers le monde, les lectaires, les passionné·es qui parlent de littérature, vous qui lisez ces lignes, moi également) en faisons partie.
Soyons-en fièr·es.
Take care, défoncez tout <3
Bibliographie
Les livres/œuvres de mes invité·es
Ketty Steward
- L’évangile selon Myriam : roman de science-fiction proposant la réécriture de plusieurs mythes, contes, et éléments de l’histoire biblique
- Confession d’une séancière, recueil de nouvelles reprenant des contes créoles
- Eugénie grandit, pièce radiophonique racontant l’histoire d’une adolescente qui apprend qu’elle a été fabriquée
- …
Sabrina Calvo
- Melmoth Furieux, roman de science-fiction autour de la commune imaginaire de Belleville
- Toxoplasma, roman de science-fiction autour de la commune imaginaire de Montréal
- Sous la Colline, roman de science-fiction dans les entrailles d’un bâtiment du Corbusier à Marseille
- …
Sam Mariem Corrèze
- Le Chant des cavalières, roman de fantasy avec une fausse prophétie et de vrais dragons à plumes
- Mus sur la brèche, nouvelle de fantasy animalière dans le recueil Fero(ce)cité
Saul Pandelakis
- La Séquence Aardtman, roman de science-fiction dans un futur où les IA sont devenues majoritaires par rapport aux humains
Sofia Samatar
- Un étranger en Olondre, roman de fantasy dans lequel la magie se trouve dans l’écriture
- The winged histories, roman dans le même univers qu’Un étranger en Olondre (non traduit)
- Monster portrait, recueil de nouvelles que Sofia Samatar a écrites avec son frère Del Samatar (non traduit)
Les essai cités
- Alice Zeniter : Je suis une fille sans histoire, un essai sur les structures narratives, plutôt court et écrit avec beaucoup d’humour
- Sarah Schulman, La gentrification des esprits, un essai qui parle de comment la culture queer a été effacée (et du rôle de la crise du sida dans cet effacement)
- Ursula Le Guin, La théorie de la fiction panier (le lien envoie vers la version complète du texte, qui est un classique quand on parle de structures narratives)
- Ursula Le Guin, La science-fiction et Mme Brown (dans le recueil d’essais Le langage de la nuit).
Recommandations de romans/nouvelles par mes invité·es et moi-même
- Akwaeke Emezi, Eau douce, un roman autobiographique sur le fait d’être, selon des termes occidentaux, « une personne non binaire avec un trouble dissociatif de l’identité » ou « possédée par le diable », et de comment s’éloigner de ces termes-là pour se redéfinir avec ses propres notions issues de la culture Igbo de l’autaire a été libérateur pour Akwaeke Emezi. Recommandé par moi-même (j’en avais parlé ici)
- Antémonde (collectif), Bâtir aussi, recueil de nouvelles qui présentent des communautés tentant de fabriquer du vivre ensemble dans un monde post-apo. Recommandé par moi-même
- Aurélie Wellenstein, Mers mortes, roman post-apocalyptique plein de rebondissement sur fond de conte écologique
- Becky Chambers, L’espace d’un an, roman qui met en scène la vie quotidienne de l’équipage d’un vaisseau spatial qui part dans un long voyage pour installer une nouvelle voie de transport spatial, recommandé par moi-même (J’en avais parlé ici)
- Carmen Maria Machado, Dans la maison rêvée, roman autobiographique relatant des violences conjugales lesbiennes, recommandé par Sofia Samatar et moi-même
- Carmen Maria Machado, Son corps et autres célébrations, recueil de nouvelles, recommandé par Sofia Samatar
- Carole Martinez, La Terre qui penche (ainsi que les autres romans de l’autrice), roman historique recommandé par Sam Mariem Corrèze
- Fran Basil, Alba de Jais, l’Anonymographe, nouvelle de fantasy animalière dans le recueil Fero(ce)cité
- Greer Gilman, Moonwise et Cloud and Ashes, deux romans de fantasy recommandés par Sofia Samatar (non traduit)
- Isaac Asimov, Cycle des Robots et Cycle de fondation, deux références majeure de la science-fiction
- J R R Tolkien, Le seigneur des anneaux, référence majeure de la fantasy recommandé par Sabrina Calvo, Sam Mariem Corrèze et Sabrina Calvo
- Jeff Vandermeer, Annihilation, roman, ou plongée consentie dans l’étrange, recommandé par moi-même
- Joël Pommerat, Ca ira (1), fin de Louis, une pièce de théâtre qui parle de la révolution française en montrant une reconstitution modernisée du type de débat dans l’assemblée nationale. La pièce a été écrite aux cours d’ateliers d’écriture collective. Recommandé par moi-même.
- Les aggloméré·es, Subtil béton, roman de science-fiction choral écrit à plusieurs mains : dans un futur dystopique, le roman montre les tentatives de diverses personnes pour raviver leurs espoirs collectifs, recommandé par moi-même
- Leslie Feinberg, Stone Butch Blues, un roman qui parle de ce qu’est être queer, de comment survivre quand l’amour ne suffit pas, de l’espoir malgré tout, de la création d’un « nous », recommandé un million de fois par moi-même.
- Louisa Hall, Rêve de Machines (titre VO : Speak), un roman qui parle d’intelligences artificielles (de 1663 à 2040), recommandé par Saul Pandelakis
- Micheal Faber, Le livre des choses étranges et nouvelles, recommandé par Saul Pandelakis
- Renee Gladman, Voyage a Ravicka, novela racontant le voyage d’une linguiste dans l’étrange ville jaune qu’est Ravicka (il y a quatre tomes en tout dont les deux premiers sont parus en français), recommandé par Sofia Samatar
- Rita Indina, Les Tentacules, roman de science-fiction évoqué par Ketty Steward
- Samantha Shannon, Le Prieuré de l’oranger, un roman de fantasy très classique de par sa forme, et très enthousiasmant à la lecture
- L’œuvre de fiction d’Ursula LeGuin, évoquée par Sam Mariem Corrèze
- Yoon Ha Lee, Le Gambit du renard, de la SF militaire et mathématique de haut vol, recommandé par moi-même
- …
Si vous avez aimé cet article, vous pouvez me soutenir !

Super article! Long comme d’hab, mais très intéressant
Bravo
Il mériterait tellement d’être relayé et publié dans des revues littéraires !